Extraordinaires
Entre moi et moi : Edith Blais, de kidnappée à confinée
« J’ai hâte de redevenir libre, faire un voyage qui se passe bien »
Cet article a d’abord été publié sur URBANIA.ca. Nous l’avons adapté pour URBANIA.fr.
SHERBROOKE– La situation est absurde et ça me rend nerveux. Je m’apprête à frapper à la porte d’un bungalow du chemin Saint-Roch, où m’attend Edith Blais, cette jeune femme maintenue en otage durant quinze mois dans le Sahara aux mains des djihadistes, qui a réussi l’exploit de leur échapper avec son compagnon italien.
Elle vient de publier le récit de cette expérience – Le Sablier – et à moins de vivre dans une grotte, vous l’avez vu dans les médias ces derniers temps.
Je voulais la rencontrer pour parler confinement, lui demander comment on passe de « kidnappée» à « confinée», puisqu’Edith a retrouvé sa liberté le 13 mars 2020 au Mali, à l’instant même où le monde entier basculait en pandémie.
Un chien aboie dans un gros enclos clôturé. Un arc-en-ciel « ça va bien aller » est collé dans la vitre.
C’est peut-être bête comme angle d’article après tout ce qu’elle a enduré. C’est ça qui me rend nerveux justement. Ça et le fait que j’ai dévoré son livre d’une traite, incluant les poèmes qu’elle a rédigés en captivité (elle a emporté les cinquante-sept dans sa fuite, avec un bidon d’eau).
Autour de la maison, il y a des arbres et de la neige à perte de vue. Un chien jappe dans un gros enclos clôturé. Un arc-en-ciel « ça va bien aller » est collé dans la vitre. Je me lance.
« On fait ça dehors ou en dedans? », demande Edith en ouvrant la porte.
Le COVID ne lui fait pas peur. Rien ne doit lui faire peur.
.jpg.webp)
Je ne sais pas trop par où commencer. Je lui explique mon idée. Elle me regarde de ses grands yeux bleus, souriant poliment à mon baragouinage plus ou moins cohérent sur un quelconque parallèle entre son cauchemar de 450 jours et la pandémie.
Je lui demande de me raconter un peu sa vie de confinée. Celle qui se passe après l’épilogue de son livre, qui se referme sur un retour chez sa mère à Sherbrooke où nous sommes actuellement.
D’emblée, elle évoque l’étrangeté de recouvrer sa liberté dans un monde de mesures sanitaires strictes, après s’être accrochée durant quinze mois à l’espoir de serrer ses proches dans ses bras.
D’abord les salutations avec le coude avec des dignitaires africains après sa libération (elle pensait au départ que c’était une coutume locale), ensuite une aile réservée pour elle dans un hôpital allemand sans oublier une infirmière paniquée qui la repousse dans l’hélicoptère Hercule qui venait de la déposer sur le tarmac pour prendre sa température.
D’une résilience olympique, Edith s’estimait surtout heureuse d’être vivante, chez elle, avec tout son petit monde en santé.
Tout ça pour enfin atterrir en mars 2020 à Sherbrooke, avec une quarantaine à respecter et l’interdiction de voir des proches hors de sa bulle. « Des gens voulaient faire preuve d’humanité, acceptaient de me prendre par la main. J’étais inquiète pour Lucas (Taccheto, le ressortissant italien et ami enlevé/libéré avec elle), puisqu’il venait de rentrer chez lui et la pandémie frappait fort là-bas », raconte-t-elle.
D’une résilience olympique, Edith s’estimait surtout heureuse d’être vivante, chez elle, avec tout son petit monde en santé. « Je rêvais de voir mes amies, pouvoir sortir, les prendre dans mes bras. Oui j’étais triste, mais j’étais contente de voir ma mère », confie-t-elle.
Edith a quand même eu droit à un discours de bienvenue et une sérénade pour souligner son retour à la maison. De l’extérieur, à l’aide d’une petite console de son et d’un micro, sa soeur lui a d’abord livré un message intentionnellement kitsch pour la faire rire tandis que la fillette d’une amie de sa mère, âgée de dix ans, lui a magnifiquement interprété deux chansons. Walking on sunshine était l’une d’elles.
« J’étais vraiment dans l’acceptation, un jour à la fois, comme là-bas. »
Elle consacrait sinon son temps à se remettre à jour, profitant des plaisirs simples du quotidien qu’on a tendance à tenir pour acquis, comme peindre, boire un café (elle a improvisé une danse du café en buvant son premier après sa libération), prendre sa douche : autant de petites choses qui n’existaient pas dans le désert, où le temps s’égrène bizarrement. La preuve, Edith a fini par se lier d’amitié avec une araignée baptisée Scarlett, avec qui elle faisait son yoga. « Je suis restée ici en quarantaine durant deux semaines, sauf pour quelques promenades avec des ami.es à deux mètres. J’étais vraiment dans l’acceptation, un jour à la fois, comme là-bas. »
Edith s’est ensuite trouvé une activité pandémique constructive : écrire un livre. Une excellente façon pour cette introvertie d’éviter de raconter son histoire à tout bout de champ.
Elle avait déjà ses poèmes et pensait au départ faire un recueil. Elle griffonnait aussi quelques anecdotes lorsque quelqu’un des Éditions de l’Homme l’a contactée. Le courant a passé et Edith a signé un contrat.
La jeune femme peint aussi, magnifiquement d’ailleurs, et on peut en voir la preuve à l’intérieur du livre.
.jpg.webp)
Comme tout le monde, Edith a hâte de retrouver une vie normale, de voyager surtout, sans trop savoir où. L’Amérique du Sud peut-être, où l’Ouest canadien où elle a déjà passé beaucoup de temps dans le passé, notamment durant l’accalmie de quelques mois l’été dernier. Bref n’importe où sauf en Afrique, où elle n’a plus l’intention de remettre les pieds. « J’ai hâte de redevenir libre, de faire un voyage qui se passe bien », résume celle qui le mérite plus que personne.
Convertie à l’islam uniquement pour retrouver Lucas après une séparation de neuf mois dans le désert, Edith Blais n’a plus besoin de prier Allah plusieurs fois par jour. Elle ne tient même pas rancune à ses geôliers, des Touaregs, qui se sont succédé nombreux et surnommés Lunettes, Barbe Rousse, Papadou ou Casse-Couille, devenus des personnages de son livre. « Les gardiens c’est des robots, rien ne vient d’eux, ils reçoivent des ordres », explique-t-elle à leur sujet, magnanime.
« Je n’avais rien à dire, ma vie ne m’appartenait plus. Je n’avais plus assez de force pour me battre dans le vide. J’étais devenue docile, un pantin entre leurs mains. J’étais leur otage, c’est-à-dire à la fois un trésor et une moins que rien. »
On se sent d’ailleurs mal de s’attacher étrangement à certains d’entre eux en parcourant le livre. Un passage – dur – m’a toutefois ramené à l’ordre, illustrant admirablement le détachement d’Edith envers ceux qu’elle désigne comme « ses gardiens ».
« Je n’avais rien à dire, ma vie ne m’appartenait plus. Je n’avais plus assez de force pour me battre dans le vide. J’étais devenue docile, un pantin entre leurs mains. J’étais leur otage, c’est-à-dire à la fois un trésor et une moins que rien. »
Même confinée, Edith reçoit beaucoup d’amour grâce à son livre, qui s’est vendu comme des petits pains en mars 2020. Le livre est déjà parti en réimpression et une version anglaise est en chantier. Des gens lui racontent l’avoir lu d’une traite, la louange pour son courage. On la reconnait dans la rue aussi. La plupart des gens la laissent tranquille, se contentant de la fixer de loin. La distanciation sociale aura eu ça de bon.
Edith garde aussi une saine distance avec les propos à son égard publiés en bas des articles sur les réseaux sociaux. Après son passage à Tout le monde en parle (ndlr, version québécoise), sa soeur est allée lire des commentaires sous une publication et lui a rapporté quelques perles. Son préféré : « Mais tu vomis-tu des arcs-en-ciel, ou quoi ?», demandait un internaute, peut-être en lien avec sa déconcertante résilience.
Hélas, les trolls n’épargnent plus personne en 2021. Pas même une femme condamnée à suivre pendant quinze mois la trajectoire de l’ombre des Acacias sous lesquels elle trouvait refuge dans le désert, pour esquiver le soleil brûlant. « C’est aussi stupide d’aller en Afrique que de porter des dreads », lui a-t-on aussi écrit.
Elle prend sinon régulièrement des nouvelles de Lucas. Le jeune homme enseigne et vit dans les montagnes, exactement comme il rêvait de faire s’il sortait vivant de cette mésaventure.
.jpg.webp)
J’ai fait le tour de mes questions insignifiantes, l’entrevue est finie. Edith se confond en excuse, réalisant avoir oublié de m’offrir à boire.
Elle met son manteau et accepte de se livrer à une petite séance photo à l’extérieur. Elle propose de m’amener dans un pit de sable au fond du terrain, où la neige immaculée s’étend jusqu’à la forêt et s’enfonce creux sous nos pas. Le gars de La Presse a fait sa photo au même endroit, me dit-elle. Comme je suis un esprit libre et que j’ai les bottes pleines de neige, je l’immortalise devant un monticule de neige. Des dunes de sable aux dunes de neige : gros concept Hugo.
En rentrant, les nuages épaississent et des peaux de lièvre commencent à descendre du ciel.
Joli prétexte pour faire référence à ce passage magnifique du livre d’Edith, en lien avec une tempête de sable qu’elle a dû affronter dans le désert. « Le temps change si radicalement dans le désert et il est tellement relatif que je me sentais prisonnière de son immense sablier. Voilà que je venais de vivre une tempête à l’intérieur même de ce dernier, là où le temps ne faisait que tourner en rond, encore et toujours. »
.jpg.webp)
La « tempête » sherbrookoise est « moins pire » et ne dure pas. J’arrive au chic motel La Paysanne, où le stationnement s’est rempli de gros truck en mon absence. Des employés d’une compagnie d’émondage de la Beauce. L’un d’eux m’interpelle pendant que je me prends pour un artiste en immortalisant le motel avec sa marquise lumineuse.
« Man pourquoi tu prends des photos? », me demande-t-il sèchement.
Sans même lui répondre, je me suis sauvé dans ma chambre me barricader pour la nuit, avec ma part de la pizzeria chez Jerry’s sous le bras.
Pas question de me faire kidnapper pendant quinze mois par des arboriculteurs beaucerons.
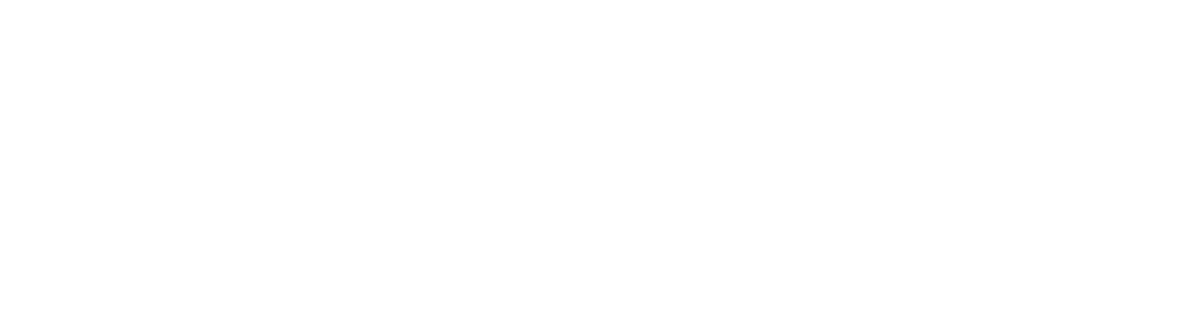
.jpg.webp)