.png.webp)
Mayotte : pas d’argent, pas de considération
Ce récit provient des ateliers d’écriture animés par les journalistes de la Zone d’Expression Prioritaire (la ZEP), un média qui accompagne l’expression des jeunes pour qu’ils et elles se racontent en témoignant de leur quotidien et de toute l’actualité qui les concerne.
*****
On avait faim. Ce qui me faisait le plus mal, c’était de voir mes petits frères et sœurs pleurer toute la journée à cause de ça. Il n’y avait parfois rien à manger pendant plusieurs jours. À Mayotte, on vivait dans une cabane en tôle. On n’avait pas d’eau courante. Il fallait aller en chercher à la rivière pour boire, et elle était polluée. On n’avait pas d’électricité. On a fabriqué une lampe avec une canette, un bouchon de bouteille en verre et une tige qui brûlait à l’aide du pétrole. Le matin, au réveil, toute la maison était noire à cause de la fumée. On n’avait pas de savon. Je me lavais seulement avec de l’eau à la rivière. Je coupais une branche de cocotier pour m’en servir de brosse à dents. Manquer de dentifrice et de brosse à dents m’a traumatisée.
Souvent, je ne pouvais pas aller à l’école car je n’avais pas de claquettes, ni de vêtements propres. Je me suis déjà retrouvée dans l’obligation de demander un cahier à une camarade de classe ou d’aller voir l’assistante sociale scolaire pour obtenir des cahiers, des stylos ou des crayons. Mais ça s’arrêtait là, elle ne pouvait rien faire pour ma situation. Quand il fallait aller en cours de sport, j’avais honte puisque je n’avais pas de vêtements de rechange, ni de chaussures adaptées. Je ne pouvais même pas me payer la collation. Pendant la pause de midi, je me cachais aux toilettes pour que les autres ne remarquent pas que je n’avais rien à manger.
Je fais partie d’une famille nombreuse. J’ai trois petites sœurs et trois petits frères, entre 19 et 7 ans. Ma mère a toujours vécu seule avec ses sept enfants. Elle a des responsabilités énormes. Elle assume tous les coûts pour nous. Mes parents sont arrivés à Mayotte des Comores deux ans avant ma naissance. Nous, les enfants, y avons toujours vécu, dans la ville de Doujani. Ma mère n’a jamais pu travailler à Mayotte, car elle n’avait pas de carte de séjour. On vivait avec zéro ressources.
Pas d’aide, beaucoup de souffrance
On survivait grâce au linge qu’on lui donnait à laver à droite, à gauche, ou au ménage qu’elle faisait chez les gens. Pour à peine 30 euros par mois. C’était loin d’être suffisant pour acheter le nécessaire. Des fois, elle partait à la campagne avec une de ses connaissances et ramenait des feuilles de manioc, des noix de coco, des bananes vertes, du manioc et d’autres fruits. Ça nous aidait beaucoup.
On ignorait à qui s’adresser pour obtenir de l’aide. On ne pouvait pas être inscrit à la CAF. Sa famille était aux Comores et on ne pouvait rien espérer d’eux car ils avaient aussi leurs propres difficultés. En plus, ils pensaient que ça allait pour elle, car elle avait rejoint l’eldorado. La famille de mon père, je n’en parle même pas, ils disaient que c’est à cause de ma mère qu’il nous avait abandonnés. Aucun homme n’a jamais voulu s’engager réellement avec ma mère, ils ne voulaient pas élever les enfants d’un autre.
Je comprenais sans qu’elle me le dise, qu’elle n’avait rien en poche. Ma mère ne voulait pas qu’on s’inquiète mais je voyais sa souffrance. Un jour, en rentrant de l’école, je l’ai surprise en train de pleurer. J’avais tellement de haine et de rancune envers mon père. Il a toujours été absent. J’ai essayé de le contacter avec des téléphones qu’on me prêtait mais, dès qu’il entendait le son de ma voix, il raccrochait. J’ai passé des mois sans nouvelles. J’espérais qu’il nous ramène le minimum, c’est-à-dire de la nourriture, mais ça n’est jamais arrivé. Il a préféré fuir ses responsabilités.
Ne pas recevoir l’amour de mon père est la pire chose que j’ai vécu. J’avais tellement besoin de lui, qu’il me rassure sur le fait que j’étais importante dans sa vie. J’aurais voulu qu’il soit à mes côtés quand j’ai obtenu le brevet des collèges, puis le baccalauréat, qu’il me dise : « Je suis fier de toi ma fille, courage pour la suite, tu vas réussir. »
Faire face aux mépris des autres
Quand tu es pauvre, tu es considérée comme une personne sans importance. On ne t’accorde pas de valeur, pas de respect, ni même la parole. Le seul sentiment qu’on peut recevoir des gens, c’est de la pitié – je l’écris par expérience. Absolument personne ne voulait nous parler. Ils pensaient qu’on allait leur demander quelque chose à manger.
J’ai vu mes camarades de classe s’éloigner quand ils ont compris que j’étais pauvre. Quand ils discutaient de l’organisation d’un événement, chacun donnait son avis mais, au moment où je prenais la parole, personne ne m’écoutait. Mon avis n’était pas pris en compte car ils estimaient que je ne connaissais rien.
Un jour, une personne m’a dit : « De toute façon, dès qu’il y aura un événement à célébrer, toi tu ne viendras pas puisque tu es pauvre, tu n’auras rien à apporter, ni à donner, tu as vu dans quelles conditions misérables tu vis ! » Elle avait dit ça avec tellement de dégoût, ça m’a beaucoup affectée. Personne ne souhaite être pauvre. J’ai souvent fait face à des fausses accusations ou des remarques comme : « Il faut faire attention aux personnes pauvres, c’est des voleurs ! »
Jamais vraiment chez nous à Mayotte
Nous avons aussi subi beaucoup d’injustices de la part des propriétaires des terrains sur lesquels nous habitions. Depuis ma naissance, on a déménagé au moins dix fois, et ça ne cesse pas. Ma mère est toujours à la recherche d’un nouvel endroit où vivre. Elle demandait à des personnes qui avaient des terrains dans le village si elle pouvait y construire un banga [petite maison mahoraise, ndlr]. À chaque fois, on nous demandait de partir car le propriétaire voulait faire des travaux dans sa maison. Il prévenait toujours une semaine avant la date de départ, donc on avait à peine le temps de rechercher un autre lieu.
On vivait dans l’angoisse d’être expulsés à tout moment, à toute heure. À notre neuvième déménagement, on n’avait nulle part où aller. On a été obligés d’aller vivre dans une cabane de tôle de vingt mètres carrés. Il n’y avait même pas de porte, juste un bout de tôle qu’on attachait avec un tissu.
À un moment, ma mère versait 50 euros de loyer pour un taudis insalubre au fond d’un champ. La propriétaire voulait que ma sœur et moi fassions le ménage gratuitement chez elle et lavions son linge pour rien, car elle estimait que ça lui était dû. Ma mère ne voulait pas, ça a créé des conflits. Elle voulait qu’on reste concentrés sur l’école et que nous ne pensions pas à autre chose.
Vivre dans la peur d’être expulsés
Un jour, mon petit frère de 13 ans s’est fait déplacer l’os du coude. Le propriétaire du champ où l’on vivait s’était mis en colère pour une salade écrasée par inadvertance et lui avait tordu le bras. Je ne pouvais pas l’emmener à l’hôpital car je n’avais pas d’argent pour le taxi, c’était déchirant. Quand on était malade, on attendait juste que ça passe. On n’avait pas de moyen de transport, pas d’assurance maladie, les médicaments étaient très coûteux à la pharmacie, et ma mère craignait aussi la police qui expulsait les Anjouanais vers les Comores.
La police nationale cherchait les personnes sans-papiers pour les reconduire chez eux. Un jour, ma mère, en allant récupérer mon petit frère à l’école maternelle, a été attrapée et reconduite aux Comores. Je n’avais que 13 ans. Nous nous sommes retrouvés cinq enfants, seuls, à vivre dans une cabane. On est resté trois semaines et demi livrés à nous-même. Ça a été une expérience très douloureuse, mais j’avais déjà l’habitude de faire les tâches ménagères. Je me suis occupée de mes frères et sœurs. Il fallait aussi qu’on aille à l’école. J’avais très peur. Heureusement, un homme généreux du village est venu nous faire les courses quand il a appris la situation.
On a souvent été harcelés, accusés d’être étrangers, on nous disait : « Pourquoi vous ne restez pas chez vous ? Personne ne veut de vous ici en France, vous n’apportez que des problèmes dans notre territoire. Vous n’avez pas honte de mendier ? Solliciter nos restes ? Vous n’êtes que des femmes de ménage qui servent à sortir les poubelles, laver le linge, s’occuper de nos enfants pendant qu’on va travailler… Vous n’êtes que des hommes bons à cultiver les champs. »
Quitter Mayotte pour la métropole
Après l’obtention de mon baccalauréat, j’ai quitté Mayotte pour poursuivre mes études supérieures en métropole. Je n’avais pas trouvé de place dans une école de Mayotte. Ladom, l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, m’a fourni un billet d’avion. À l’arrivée, les choses ont été difficiles. Il fallait que je m’adapte au nouveau mode de vie, au climat, que je m’intègre. Je me suis sentie seule.
Le plus dur a été ma scolarité. J’ai tellement galéré à trouver un logement que j’ai dû faire des déménagements réguliers chez des connaissances. Ça ne se passait pas toujours bien. En échange d’un toit, les gens me demandaient de m’occuper de tout, du ménage, des bébés la nuit. À ça, s’ajoutaient les problèmes financiers. Heureusement, j’ai fini par avoir mon propre logement étudiant, au Crous. Je me suis débrouillée toute seule, et je ne me suis jamais découragée.
J’ai toujours été une étudiante assidue, avec beaucoup de volonté, j’essayais de mon mieux de surmonter mes lacunes et de m’améliorer à l’école. Je me suis dit que je devais réussir ma formation, mon BTS SP3S (services et prestations des secteurs sanitaire et social). Avoir un travail convenable est la seule chose qui peut me sortir de la pauvreté, je ne veux plus que mes proches subissent ces conditions dures et effrayantes. Je ne veux plus être pauvre.
Nadia, 21 ans, étudiante, Lyon
Identifiez-vous! (c’est gratuit)
Soyez le premier à commenter!
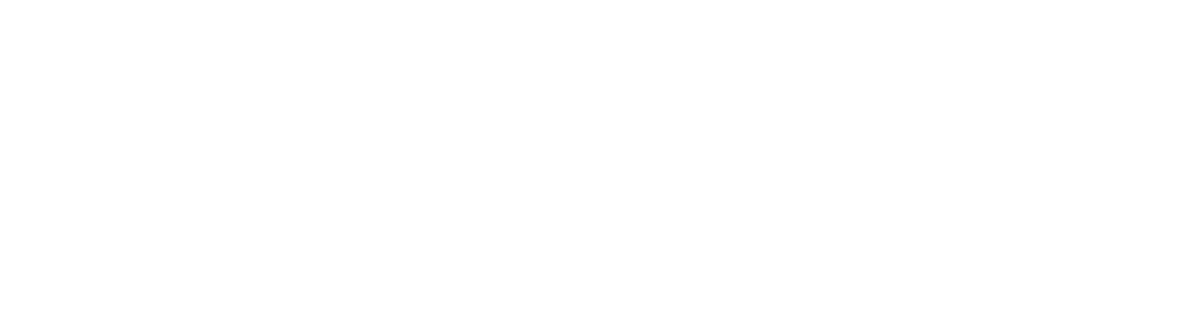
.png.jpg)
.png.webp)