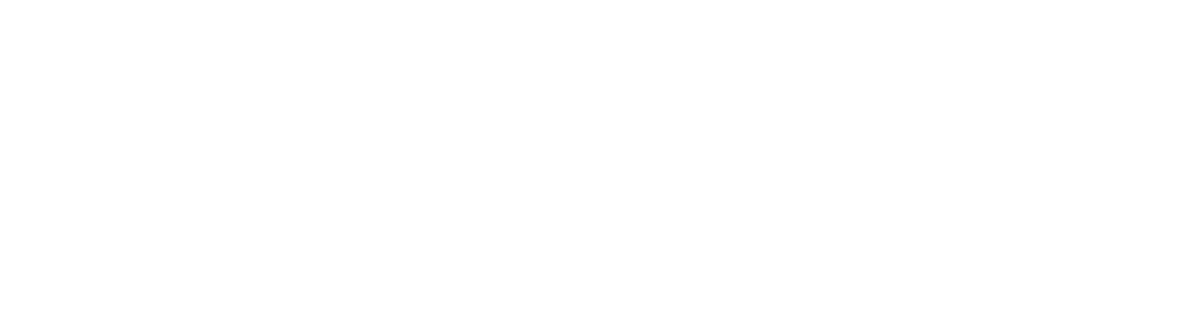.jpg.webp)
Marie Dasylva, coach contre le racisme : « Je vois mon travail comme celui d’une ambulance »
On lui a demandé comment « Survivre au taf » quand on fait partie des personnes minorisées.
Vous l’avez peut-être déjà croisée sur Twitter sous l’alias @napilicaio ou Blackiavel. Marie Dasylva est « coach stratégiste » : elle accompagne des personnes qui vivent le racisme sur leur lieu de travail, parfois aussi le sexisme, l’homophobie, le validisme, etc. Marie a sorti le 28 janvier aux Éditions Daronnes son premier livre : Survivre au taf. Stratégies d’autodéfense pour personnes minorisées. Pour URBANIA, elle revient sur son travail, son parcours, ses méthodes.
On vous connaît à travers votre compte @napilicaio sur Twitter et votre agence, Nkaliworks. Pourquoi avoir voulu écrire un livre ?
L’objectif premier de ce livre, c’est de réparer, donner à réfléchir et faire comprendre à toutes les personnes racisées que leur voix est importante, et que même si leur vécu n’est pas reconnu, il a existé. Je voulais que les personnes concernées puissent avoir cet objet auquel se référer, leur petite bible de survie au travail.
Il présente un éventail de méthodes intéressantes pour que tout le monde puisse y puiser. Toutes les personnes que j’ai accompagnées sont racisées, mais elles vont être presque toujours à l�’intersection d’autres oppressions.
La forme finale est totalement différente de ce à quoi j’avais pensé initialement. J’avais imaginé un guide très pratico-pratique, et on se retrouve avec un livre qui a aussi quelque chose de très lyrique. Au début, j’écrivais quelque chose de désincarné mais je me suis rendue compte que c’était important de retranscrire d’où je parlais, ce que je pouvais ressentir, ce qui m’a amenée à faire ce travail.
https://twitter.com/napilicaio/status/1489600628640858112
Qu’est-ce que ce format apporte, par rapport aux histoires que vous avez déjà pu raconter sur Twitter ?
Plus j’avançais, plus je me rendais compte que Twitter représentait quelque chose de volatil. Ça reste un format limité, fait pour la punchline. On ne peut pas étayer un propos. Mon compte, c’était plutôt une mise en bouche, un moyen utilisé pour faire connaître mon travail, et là, j’avais envie de faire quelque chose de plus posé, de développer un peu plus.
Par Twitter, j’ai pris conscience de l’ampleur du phénomène. Le fait que de plus en plus de personnes me disent : « En te lisant j’ai pris conscience que ce que je vivais n’était pas normal », ça m’a donné la force de continuer. C’est encore mon moteur aujourd’hui.
Comment en êtes-vous venue à vous intéresser aux oppressions au travail ? C’est votre parcours qui vous a mené vers ce métier ?
J’ai travaillé dans la mode. Pendant dix ans, chaque fois que j’entrais dans une pièce, j’étais la seule femme noire. Je ne suis pas arrivée en tant que Marie Dasylva, mais en tant que personne hors norme, dans un milieu complètement normé, au niveau de la race, du genre et de la classe. Et forcément, ça donne des micro agressions constantes, du déni de compétence. Mon évolution professionnelle a toujours été remise en question.
Je n’arrivais plus à faire face à l’absurde de ma situation. J’ai été licenciée, s’en est suivie une dépression de deux ans, parce que j’avais perdu mon statut social. J’ai senti que le salariat n’était plus pour moi. J’ai commencé à réfléchir à mon histoire, j’ai pris un cahier, pour détailler ce qui m’était arrivé. J’ai demandé aussi autour de moi : « Est ce que tu as vécu ça, en tant que personne racisée au taff ? », et la réponse était invariablement oui.
C’est là que je me suis rendu compte que ce que je vivais n’était pas quelque chose d’individuel, mais de systémique. Et j’ai toujours eu cet esprit de recherche de solutions. Donc j’ai commencé à imaginer des stratégies d’auto-défense, a postériori pour moi, ou en discutant avec des proches. Mon travail, c’est l’histoire d’un contre-transfert. Je me rejoue à chaque nouvelle personne que j’accompagne.
Vous avez fondé votre agence de coaching stratégique, Nkaliworks, qui accompagne des personnes victimes de discriminations au travail. Comment est-ce qu’elle s’organise, et comment a-t-elle évolué ?
En 2017, j’ai mené mon premier coaching collectif, et j’ai commencé à me professionnaliser vers 2020. Depuis que l’agence existe, j’ai dû suivre une centaine de personnes. J’ai appris, depuis, qu’on ne gagne pas tout le temps. Et qu’on pouvait perdre bien, sans regrets, en sachant qu’on a tout essayé.
En général, je vois les personnes coachées toutes les deux semaines. On va avancer pas à pas dans notre stratégie, voir comment l’environnement réagit, et réadapter. Pour un cas de négociations salariales, on se verra deux fois et ce se sera plié. Pour un cas de harcèlement, je peux suivre la personne pendant six mois.
Je leur conseille toujours de suivre une thérapie, parce quand on parle de situations problématiques, de harcèlement au travail, on parle souvent de traumas. Mon travail complète assez bien ce qui peut être fait en thérapie. Je travaille avec d’autres professionnels, des avocats, des psychologues, le plus souvent concernés par le racisme. Je recommande aussi souvent les syndicats. L’idée, c’est que la personne puisse avoir accès à un écosystème de protection via un seul point de contact qui va être mon agence. Pour les tarifs, je m’adapte au revenu de la personne. C’est un système assez démocratique : l’avocate d’affaires racisée va payer pour l’employé·e du McDo. Je fais beaucoup de gratuité, pour que tout le monde puisse avoir accès aux services.
Vous écrivez dans le livre que vous travaillez sur la question de la domination raciste au travail comme « un algorithme à résoudre »? Comment résumeriez-vous votre méthode ?
Imaginer des scénarios plausibles à partir de ce que la personne est, de ce qu’elle est capable de faire, de ce que je peux percevoir de son environnement. C’est un travail de création de possibles.
Pour donner un exemple, une stratégie intéressante, c’est celle de la question. Prenons le cas d’un manager qui veut saquer un ou une employée. Il va forcément être flou, puisqu’il n’a pas la vérité de son côté. Pour ne pas être enfermé·e dans cette narration que l’on sait fallacieuse, il faut questionner. Donc j’ai une méthode qui s’appelle « Mais où est donc Ornicar ». À chaque fois que le manager dit quelque chose comme « Tout le monde dit que tu es fermé·e », vous allez répondre : « Qui a dit ça ? Comment ? À quelle date ? Pourquoi on ne m’en a pas parlé plus tôt et pourquoi on m’en parle aujourd’hui ? ». Il s’agit de pousser l’autre dans ses retranchements, le forcer à battre en retraite en évitant d’être labellisé·e agressif·ve.
Une règle que vous conseillez à toutes les personnes racisées repose sur les « 300 secondes ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Les trois cents secondes sont un outil de gestion de son temps par rapport à l’oppression. L’objectif, c’est de réduire le temps qu’on passe à justifier de son humanité. Il faut le voir comme une espèce de digue mentale. En préservant notre temps des oppresseurs, on ne leur donne pas accès à nos émotions.
On se dit : « J’ai 300 secondes dans la journée à consacrer au racisme ou au sexisme ». Ça veut dire que je ne perds pas de temps à débattre sur Internet, ou à rentrer dans des discussions qui vont prendre toute mon énergie au boulot, parce que j’estime que j’ai mieux à faire.
Dans ces conversations, il faut adopter des réponses lapidaires. Il y a quelque chose de vicieux dans le fait de demander, à une personne que l’on sait musulmane, ce qu’elle pense de ce qu’a dit Zemmour la veille. Cette personne, au lieu de se lancer dans une justification, peut répondre : « Moi je ne parle pas politique au boulot, je ne suis pas là pour discuter de Zemmour ».
Pourquoi avez-vous choisi le prisme de l’autodéfense individuelle pour lutter contre le racisme ?
La réponse à l’oppression est évidemment collective – on ne peut pas imaginer sa fin sans l’établissement d’un rapport de force. Mais je vois un peu mon travail comme celui d’une ambulance : aider, “réparer” des individus.
C’est quelque chose qui est né de la frustration. Il y avait cette idée cathartique de défendre celles et ceux qui ont partagé à un moment donné le même destin que moi, comme j’aurais aimé être défendue à l’époque. Lorsque j’ai vécu ce que j’ai vécu au travail, il n’y avait personne pour me conseiller et pour m’aider. Donc j’ai créé Nkaliworks à partir du manque que j’ai pu ressentir.
Vous vous adressez uniquement aux personnes racisées, pourquoi avoir choisi ce prisme comme domination principale autour de laquelle vous travaillez, et pas par exemple le sexisme ou la grossophobie ?
Le racisme est une oppression capitale, sur laquelle s’est construite notre société. Et c’est aussi ce que j’ai le plus durement vécu. Quand des personnes racisées veulent se faire accompagner sur ces problématiques, elles ont du mal à être entendues. Lorsqu’elles parlent de racisme, à un psy blanc par exemple, va se poser la question avant de lui raconter un incident raciste : « Est-ce que je lui en parle ou pas, est-ce qu’il va être capable de comprendre ? Est ce qu’on va balayer ce que je vis sous le tapis ? ».
Quand on est une femme racisée, la question se pose aussi. Nos problématiques ne sont pas considérées comme des problématiques féministes, parce qu’on est rarement considérées comme des femmes.
Et pourquoi aborder cette question au travail, pas dans d’autres domaines, comme les cercles amicaux ou familiaux ?
Le travail reste l’espace de domination ultime. C’est un rapport de domination tellement écrasant, à la David et Goliath, que je trouve intéressant de remettre en question. Et c’était naturel pour moi parce que c’est aussi la sphère où j’ai le plus souffert ; j’ai détesté le travail avec passion.
Je pense qu’il n’y a pas énormément de différences par exemple, entre une situation problématique dans une famille, et une au travail, le rapport de domination peut être tout aussi violent. C’est juste que dans la famille, les leviers sont beaucoup plus sensibles. Au niveau du travail, on peut utiliser le droit, mobiliser les syndicats, etc. Donc, c’était plus traitable pour moi, par rapport au niveau de compétence que j’avais.
Quels points communs retrouvez-vous en travaillant sur des oppressions différentes, au niveau du vécu des personnes coachées et des stratégies que vous pouvez mettre en place ?
Les effets sur la santé, d’abord. Des personnes développent des symptômes tels que des ulcères, des migraines, ou au niveau de la santé mentale, des dépressions, du stress post-traumatique, des burn out, un syndrome de l’imposteur… Je les retrouve dans à peu près tous les cas que j’ai pu traiter.
Ce qui est commun pour les stratégies, c’est visibiliser le problème et créer de la preuve avec des écrits, pour avoir un dossier prêt si on part sur le terrain du droit. On met aussi en place des protocoles pour sécuriser la personne mentalement, pour minimiser les effets que l’oppression a pu avoir sur elle. Ça passe par la tenue d’un journal, insister pour qu’elle fasse une thérapie, etc.
Le fait de parler est aussi une étape importante. Lorsqu’on parle, on est déjà en train d’aller vers la sortie de crise, du huis clos oppressif. Ça aide à mieux délimiter des responsabilités, à se dire : « Je ne suis pas responsable de ce qui m’arrive ». Se définir comme victime peut être le début d’un « empowerment », parce que c’est le début de la lutte.
Quelle différence faites-vous entre votre travail, et celui d’un·e psychologue ?
Mon travail ne saurait se substituer à une thérapie parce que je n’ai pas les qualifications. Le psychologue vous écoute, vous donne des axes de réflexion. Moi, j’interviens sur la stratégie, quelque chose de très terre-à-terre, par exemple comment tu vas t’habiller pour aller affronter ton chef, qu’est-ce qu’on va lui dire… Je vais bientôt me former sur la psychologie, mais ça sera pour devenir une meilleure coach.
D’ailleurs, quelle importance a la santé mentale dans votre travail ?
La santé mentale est primordiale. Mon travail, c’est de faire prendre conscience aux gens que c’est aussi vital que de respirer ou manger ou se laver. C’est quelque chose qui est souvent négligé, parce que les personnes racisées ne sont pas censées faillir. Cette injonction à la force est une forme de déshumanisation.
Vous écrivez dans votre livre que « la colère, c’est le premier pas vers une dignité retrouvée ». Quelle place a-t-elle face aux oppressions selon vous ?
La colère, c’est l’émotion qui vient après la prise de conscience que ce qui nous est arrivé est anormal. C’est une preuve d’amour envers soi parce qu’on se dit : « je n’ai pas à être traité·e comme ça ». Ça devient quelque chose de moteur lorsqu’on ne dirige pas cette colère vers soi, mais vers ceux qui la méritent.
Quels conseils principaux donneriez-vous à quelqu’un qui vit le racisme au travail, lit cet article et ne saurait pas trop par quoi commencer ?
Premièrement, on n’a pas le temps de ne pas demander de l’aide. C’est une compétence de survie, d’autodéfense, comme l’écrit Stella Tiendrebeogo, la psychologue qui a écrit la préface de mon livre. Le premier conseil, c’est toujours d’en parler autour de soi.
Le deuxième, ce serait de regarder du côté du droit. Se demander : « Est-ce que ce qui m’arrive est illégal ? Comment je collecte des preuves ? Comment je trace ce qui s’est passé ? ». Ça répond à un double objectif : pouvoir éventuellement attaquer aux prud’hommes, mais aussi se rappeler que c’est réel. Le racisme qu’on vit au travail ne sera jamais considéré comme quelque chose de sérieux. Le visibiliser par des écrits, ça fait escalader la situation mais ça permet surtout de se défendre sur le long terme.
Si vous n’avez pas d’alliés dans la structure, et que vous vivez quelque chose de difficile, il faut déjà être dans l’optique que vous allez partir et se demander comment. On peut faire appel à des acteurs extérieurs : une coach comme moi, un·e thérapeute, un·e ami·e. Pour en parler, pour réfléchir et pour trouver de la ressource. Rencontrer des interlocuteurs qui vous permettent de supporter cette situation, et préparer son départ.
Identifiez-vous! (c’est gratuit)
Soyez le premier à commenter!