.jpg.webp)
Ma zone (pavillonnaire) à moi
Hier après-midi, grâce à Twitter, j’ai découvert un magnifique texte de l’architecte et urbaniste Maxence De Block. Ses mots m’ont replongée en enfance, telle une madeleine de Proust. J’ai même eu des petits frissons en lisant certaines parties de son texte. « La “France moche”, c’est chez moi. J’ai fêté pas mal d’anniversaires à Buffalo Grill, j’ai été habillé à la Halle Aux Chaussures, j’ai été élevé au rayon bande dessinée d’Auchan et aux DVD de Vidéo Futur. » J’ai eu envie de lui dire bravo et merci de rendre hommage à ces royaumes d’enfance oubliés. Parce que c’est d’abord ça, une « zone pavillonnaire ».
Impossible à comprendre quand on n’y a pas grandi. Il faut l’avoir vécu pour connaître la richesse de ces « funestes et pitoyables cadres de vie » pour paraphraser l’architecte et critique d’art Christophe Le Gac qui a mal cerné les états d’âmes de nos « zones pavillonnaires ».
Moi je suis née à Courcouronnes, à une vingtaine de kilomètres de Paris, dans le département de l’Essonne. En banlieue parisienne, donc. Dans le 9.1 précisément. J’en avais déjà parlé un peu ici. Pour certains (partis politiques), Courcouronnes c’est surtout « la zone » tout court. Presque une “No-go zone”.
Mais c’est à Saintry-sur-Seine que j’ai grandi dans une zone pavillonnaire où mes parents avaient décidé d’acheter leur première maison, après avoir vécu de (trop) nombreuses années dans un HLM à Ris-Orangis avec mon frère et ma soeur.
Petite, et en tant que “petite dernière” de la famille, on m’a toujours fait sentir que j’avais de la chance de grandir à Saintry dans une maison avec jardin. J’ai mis du temps à comprendre pourquoi.
C’est à Saintry que j’ai appris à faire du vélo, du roller, du tracteur (en plastique), de la moto (électrique), à courir vite après avoir lancé un pétard dans le bac à sable du voisin, à faire des potions magiques à base d’essence (sans le savoir), à faire des tâches d’essence sur mon kimono (du coup), à chasser les inconnu.es qui s’aventuraient dans notre “zone” à coups de pistolets à pétards (encore), à défoncer les genêts de mon père pour faire une cabane, à me racler les genoux à plat ventre sur mon skate, à comprendre pourquoi “le poil à gratter” s’appelle comme ça, à “emprunter” clandestinement un chiot parce que je le trouvais beau, à chantonner le jingle de Sega (Megadrive) en jouant à Sonic, à organiser des goûters d’anniversaire, à vivre mes plus belles histoires d’amitié (voire d’amour-amitié), à jouer au foot dans les “espaces verts”, à péter les phares de la voiture du voisin en jouant (trop fort) aux billes, à dealer des Pogs, etc.
Bref, c’est là que tout ce que je suis aujourd’hui s’est construit. Sans Saintry et ma rue de la Plaine, je ne serai peut-être pas là en train d’écrire ce papier. Mais ça, on l’oublie, on entend rarement des choses positives sur ces “zones pavillonnaires” et à quel point elles peuvent vous « élever » dans tous les sens du terme.
« Ce mépris vis-à-vis de ces lotissements de banlieue me révolte car c’est toute notre vie de famille qu’ils décrivent comme si nous étions tous des cons. Moi je suis fière, je n’oublie pas d’où on vient et mes enfants prouvent, par leurs parcours respectifs, qu’on vit très bien dans ce contexte. Le plus important à mes yeux, ce sont les souvenirs d’enfance, les goûters, les copains, les jeux dans les lotissements, etc : ça ne s’oublie jamais, c’est le plus précieux », m’a encore confié ma mère ce matin quand je lui ai dit que j’essayais d’écrire sur Saintry.
Vivre et grandir en banlieue, en zone pavillonnaire, c’est savoir que la vie n’est pas toujours bien faite mais qu’en se donnant les moyens, on est capables de parvenir à ses fins. C’est aussi se sentir visé quand on entend parler de « quartiers moches, gris, bétonnés, de maisons qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau, de classes moyennes qui s’entassent », etc. Mais c’est aussi apprendre à s’en foutre et à se débrouiller « au cas où » le crédit maison des parents serait plus compliqué à rembourser que prévu. C’est juste faire preuve de lucidité.
Et le plus important selon moi, grandir dans un tel environnement c’est savoir qu’il faut de tout pour faire un monde : des Pierre, des Paul, des Kimberley, des Fatoumata, des Hayako, des Dado, des Binta, des Alexis, des Nina, des Vanessa, des Coraline, des Jessica, des Ludivine, des Stephen, des Steven, des Fabrice, des Anthony, des Cédric, etc. Désolée pour les potes d’enfance que je zappe, vous étiez bien trop nombreux !
Alors c’est sûr, on n’avait pas « les deux pieds dans le même sabot », comme disait ma grand-mère chez qui j’avais la chance de vivre chaque été, dans une grande maison au bord de la mer, en Bretagne. Mon deuxième havre de paix après Saintry. Parce que oui, j’aimais autant le béton de ma banlieue que le sable (tiède) des plages bretonnes. Là où il y avait de l’amour, je me sentais chez moi partout.
Parce que c’est ça aussi une « zone pavillonnaire » : des parents qui font de leur mieux, qui en arrachent (comme on dit au Québec) tous les jours pour que leur famille profite des moindres petits moments qui font que la vie vaut la peine d’être vécue. Qu’importe la couleur des murs ou la taille du jardin.
Ironie du sort, j’écris ce texte à quelques heures de passer chez le notaire pour devenir à mon tour propriétaire. Il n’y a pas de hasard. Ce n’est pas en “zone pavillonnaire” que je vais m’installer mais ma démarche est la même que celle de mes parents lorsqu’ils ont acheté leur première maison : faire de cet endroit une boîte à souvenirs inoubliables. À commencer par ceux de mon petit chou de 2 ans ET DEMI qui, un jour peut-être, parlera de Montréal avec autant d’amour que moi pour Saintry-sur-Seine. L’avenir nous le dira…
Identifiez-vous! (c’est gratuit)
Soyez le premier à commenter!
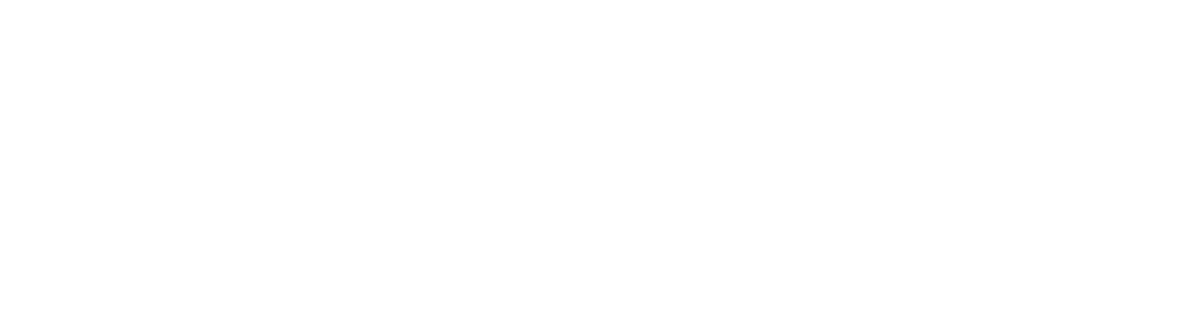
.jpg)
.jpg.webp)