.jpg)
“Le temps, petit Simon, où tu m’arrivais à la taille
Me semble encore tout à l’heure et déjà tu m’arrives au cœur.”
-Serge Reggiani
Dans le film Boyhood, il y a une scène où le fils d’environ 19 ans s’apprête à quitter la maison pour étudier à l’université. La mère (Patricia Arquette), qui jusque-là ne s’était pas montrée particulièrement émotive, s’effondre de voir arriver ce moment. Dernière d’une série d’étapes vers la maturité de ses enfants, qui se seront enchaînées si vite…
« And what’s the next step? », lance-t-elle en pleurant et en frappant sur les murs. « My funerals? »
Cette scène m’est revenue en tête il y a quelques semaines quand la plus jeune de mes filles a ramassé sa couverture et son doudou et qu’on a quitté, pour la dernière fois de sa vie (de notre vie) la garderie.
J’avais la face rouge et bouffie d’avoir essayé de ne pas pleurer en disant adieu aux éducatrices. Ça faisait une semaine que j’y pensais. Le jour F (pour Fin), Petite fille ne s’est même pas retournée dans l’escalier. Tout entière à ses préoccupations : « Qu’est-ce qu’on mange? » La gravité du moment lui échappait complètement…
Mais PAS À MOI ! On ne reverrait plus ces femmes qui avaient été si présentes et si précieuses dans notre vie depuis quatre ans (surtout dans les moments difficiles). À moins de faire le détour jusqu’ici…
Pire. En cette fin de garderie, moi je n’avais plus de bébé.
Déjà… ?
Mais, mais, mais… il y a un malentendu. Je vous jure, je viens juste d’accoucher de cette enfant-là !
***
J’ai toujours souffert d’hypersensibilité au temps qui passe.
Bon, OK, d’hypersensibilité tout court, mais particulièrement au temps qui passe.
Au fond, n’est-ce pas LA grande affaire poignante de la vie ? Le temps qui fait apparaître et disparaître des êtres humains. Le temps qui fait apparaître et disparaître des relations. Le temps qui fait apparaître (et pas disparaître) les rides… On peut vraiment s’habituer ?
Tout ça avec, pour décor, le cycle des saisons qui s’enchaînent et se ressemblent : vert vif, vert doux, orange, blanc… Oups, une ride de plus ! Vert, vert, orange blanc… Et une autre ride au front. Parfois un deuil. Feuille tombée.
À l’école primaire, je pleurais toutes les larmes de mon corps à chaque fin d’année scolaire, comprenant chaque fois intuitivement que ce qui avait été (cette classe, cette relation avec ce professeur, ces rires, ces complicités, cette ambiance-là, précisément celle-là) ne serait plus jamais. Et triste de ne pouvoir embouteiller ce « ça » pour pouvoir y plonger quand je m’en ennuierais…
Je m’attache trop à ce que j’aime – les gens, les lieux — et je voudrais que ça reste là tout le temps.
J’ai toujours eu du mal avec les déménagements, les ruptures, les changements. Je m’attache trop à ce que j’aime – les gens, les lieux — et je voudrais que ça reste là tout le temps. Je souffre à l’avance de savoir que les choses aimées, un jour, ne seront plus. Ou plus exactement pareilles.
Par exemple, ce petit appartement où j’ai atterri après ma séparation. Petit nid bordélique plein de lumière. Des livres, un piano, des dessins d’enfants sur les murs. Des rideaux fleuris.
Ma maison à deux sous, palais de Versailles de ma reconstruction, en réalité, ne paie vraiment pas de mine comparée aux maisons de mes amis encore en couple…
Cet appartement, je sais que je ne l’habiterai pas toujours. Il viendra un moment où j’aurai davantage de moyens (j’espère !). Où on le trouvera trop petit pour nous trois.
C’est fou, mais je suis triste à l’avance. Je m’en ennuie déjà.
C’est ridicule, je sais.
***
En fait, j’en suis consciente : la peur de perdre des êtres chers ou des choses (ou de les voir changer) est bien souvent plus difficile à vivre que la perte elle-même. L’humain est fait pour survivre au deuil, pour se transformer à travers lui…
Longtemps, par exemple, j’ai pensé que je ne serais pas capable de vivre dans un monde où mon père n’existerait pas. Dans un monde où la voix de mon père ne résonnerait plus. Et pourtant. Douze ans que je me passe de lui. Que je vis dans un monde sans. Sans sa voix, sans son sourire, sans ses yeux, sans son odeur. Sans ses conseils.
Un monde sans mon père qui traîne ses pantoufles sur le plancher de bois franc. Un monde sans lui qui rajoute du sel et du vinaigre dans ses chips sel et vinaigre. Un monde sans mon père pour faire jouer des chansons de Noël en octobre… Douze ans passés comme une étoile filante.
Étoile qui m’a laissé dans son sillon deux petites filles que tu n’as pas connues, papa. Deux amours qui m’ont transformée en maman. La vie a continué. J’ai même été heureuse ici-bas sans toi, papa. C’est fou. Et ça m’arrive encore.
En fait, je dirais même que quand ça arrive, c’est plus beau et plus précieux que le bonheur que j’avais connu avant. Parce qu’il y a de la tristesse dedans.
***
L’autre jour, à brûle-pourpoint, ma grande de huit ans m’annonce, en prenant son bain : « Je suis une préado, maman ».
Ah bon ? Les deux bras m’en sont tombés. Comment ça, une préado ! Je n’ai même pas eu le temps de te voir pousser !
On peut mettre ça sur pause ?
Apparemment non. Preuve : le grand garçon de mon amie Brigitte a la voix qui mue et une petite ombre de moustache au-dessus de la lèvre… Je vous le JURE, hier, j’étais là et il avait la couche aux fesses.
Stop ! Un petit bout au ralenti svp, Monsieur le projectionniste.
***
Je sais, la vie c’est ça. Apprendre à vivre, c’est accepter que tout change. Que rien n’est permanent ou que « tout est temporaire » comme dit Daniel Boucher. Que tout ce qu’on a pour nous, au fond, c’est le moment présent. Qu’il faut prendre le temps d’habiter sans regretter à l’avance ce qui, tôt ou tard, ne sera plus…
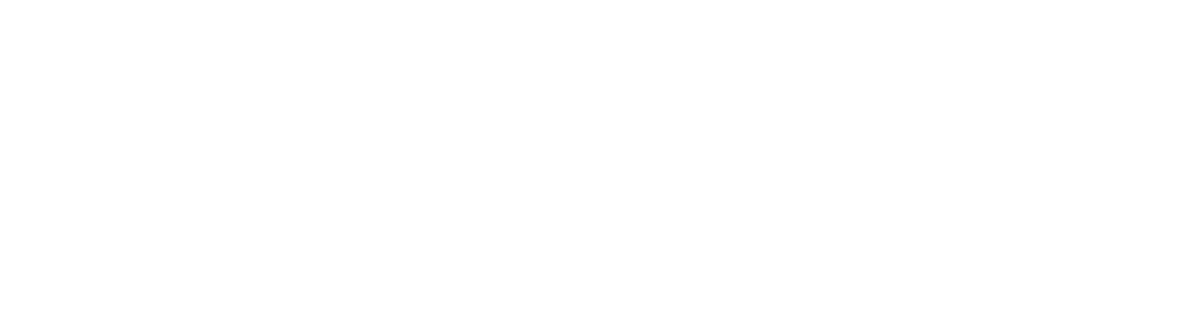
Identifiez-vous! (c’est gratuit)
Soyez le premier à commenter!