.jpg.webp)
Prendre soin de soi, d’accord. Mais est-ce qu’on a oublié le « nous » au passage?
Est-ce que prendre soin de soi s’accorde seulement avec le pronom « je »? C’est la question qui résonne en moi après avoir visionné le vibrant témoignage qu’a livré la chef cuisinière et militante du mieux-être Sophia Roe sur sa page Instagram la semaine dernière. «Après toutes ces retraites spirituelles à Bali, ces séances d’acupuncture, ces rituels sur votre mieux-être, si vous ne faites rien pour votre communauté, vous avez manqué le bateau», avance-t-elle.
Sophia insiste: le seul et unique but d’apprendre à s’aimer devrait être de trouver les bons outils pour supporter sa communauté.
Si ma psy m’a demandé d’être indulgente envers moi-même dans ces mois brouillons, comment ai-je transféré mes apprentissages acquis à coup de grandes lectures et de randonnées à une communauté qui pourrait bénéficier d’une paire de bras supplémentaire ?
Ai-je manqué le bateau ?
DÉPENDRE DE SA COMMUNAUTÉ
Sophia raconte que dans son quartier black and brown, à New York, les gens se saluent quand ils sortent de leur maison, ils se disent bonjour. «Ils doivent le faire. Parce que s’ils ne le font pas, personne ne le fera», insiste-t-elle. Elle milite pour une plus grande ouverture.
«On se fait convaincre par plein de discours que le bien-être à affaire avec le «je», mais peut-être que le mieux-être doit être quelque chose qui doit être partagé pour être durable et pour qu’on puisse parler de justice sociale.»
Mais le concept de la communauté, comment peut-on le définir concrètement? C’est mon entourage? Ma famille, mes amis ? Mon quartier ? « C’est le sentiment d’appartenir à un groupe, mais c’est très subjectif, me lance le professeur en sociologie, Rachad Antonius. Ça peut être communautaire ou le monde en général, et entre les deux, la nation, le groupe auquel on s’identifie », en prenant l’exemple d’un groupe ethnique, religieux, ou encore les habitants de son quartier.
Dans son témoignage, la chef livre un plaidoyer élogieux envers sa communauté, mais aussi truffé de critiques acerbes sur le mieux-être en général: un terme qui est galvaudé, selon elle, et qui mériterait une seconde perspective: « wellness is not just about you, it’s about we.»
«Je trouve ça très puissant comme message», me lance la professeure en sociologie, Chiara Piazzesi. « On se fait convaincre par plein de discours que le bien-être à affaire avec le «je», mais peut-être que le mieux-être doit être quelque chose qui doit être partagé pour être durable et pour qu’on puisse parler de justice sociale. »
UN MESSAGE À CONTRE-COURANT
Ce que Sophia déplore, c’est qu’après tout ce temps investi pour récolter un teint radieux, une paix d’esprit, les bénéfices ne sont que personnels. Ils ne profitent à personne d’autre. Elle défend un mieux-être collectif qui se traduirait par des actions concrètes, pas par un masque par semaine; de la bienveillance pour notre communauté et une participation active qui s’inscrivent dans un discours politique très actuel (avec le mouvement Black Lives Matter, entre autres) et qui revendiquent de plus larges ressources pour les populations racisées et marginalisées.
UN DISCOURS LOIN D’ÊTRE UNANIME
Au bout du fil, le psychologue Jean-François Vézina me met en garde contre ce type de discours, très passionné, mais qui peut se révéler culpabilisant et moralisateur.
En contexte de pandémie, la question reste toutefois légitime : «Quand j’ai peur, à qui je donne mon pouvoir ? À mon image ou aux liens avec les autres ?», me demande-t-il. «Est-ce que je prends soin de ma relation avec l’autre qui n’est pas comme moi ?»
«Nous sommes ce que nous sommes en raison de la collectivité. C’est grâce à cette culture qu’on est capable de penser.»
Le professeur en sociologie, Rachad Antonius, dénote aussi un angle mort dans le discours de Sophia : «On dépend de la communauté pas par gentillesse, mais parce qu’on n’existe qu’à cause de la collectivité. » Il poursuit, catégorique: «Nous sommes ce que nous sommes en raison de la collectivité. C’est grâce à cette culture qu’on est capable de penser.»
ABANDONNER LE «JE» POUR LE NOUS
Dans l’histoire, il y a des moments cruciaux où les individus ont dû sacrifier le «je» au profit du «nous». Les deux guerres mondiales, des moments de crises, les pandémies. «Si les gens ne se sacrifiaient pas, c’était toute la survie de la collectivité qui était menacée. Si les individus font passer leurs intérêts avant ceux du groupe, on ne peut pas survivre et les plus faibles vont mourir. On ne vit que par solidarité sociale», poursuit M. Antonius, passionné par le sujet.
Il m’explique que récemment, nous sommes passés par une période qui a valorisé l’individu et la consommation à outrance, ce qui a plongé notre monde dans des inégalités sociales et des crises environnementales. «La modernité a fait qu’on a sacrifié la collectivité et là, on doit changer. C’est pas une mince affaire et ça se déroule sous forme de lutte sociale», me rappelle M. Antonius. «On a besoin d’une collectivité pour survivre», termine-t-il.
C’est un rappel à la dimension collective, politique, des défis que l’individu en société doit prendre en charge. Dont moi et vous aussi.
Identifiez-vous! (c’est gratuit)
Soyez le premier à commenter!
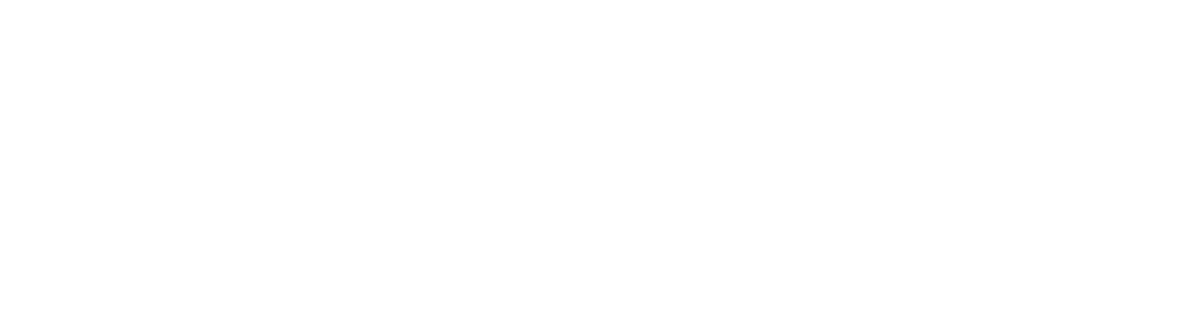
.jpg.webp)