.jpg)
Jour 6 : un homme esseulé, carton sur la tête, se rêve en pleine nature. Jour 12 : un homme avec une pagaie s’apprête à dévaler un toit. Jour 32 : étreinte illusoire entre un être de chair et une femme dessinée.
Le 17 mars 2020, le premier confinement est décrété. Philippe Hérard rejoint sa mère dans son gîte à la campagne, pour s’occuper d’elle, et profiter d’un plus vaste espace que celui de l’appartement familial situé à Belleville à Paris.
Pendant 56 jours, le peintre de chevalet devenu street artiste sur le tard, s’est astreint à réaliser au quotidien une œuvre sur carton en tentant de s’imaginer ce que pouvait ressentir les personnes contraintes à la solitude. « Je me suis mis à la place de ceux qui seraient enfermés avec un besoin de communiquer et de sortir. Cela fait à peu près trente ans que je fais des peintures de confinement, c’était donc facile pour moi de rentrer dans le sujet. Depuis le départ, ma peinture introvertie met en scène des personnages dans des situations toujours un peu compliquées. » Loin de son petit atelier jonché de tâches de peintures dans lequel sont entreposés ses accessoires fétiches (chaise, pagaie, bouée…), il demande à ses partenaires de confinement (sa fille ou sa femme) de le prendre en photo dans des saynètes incongrues. Lui d’ordinaire si discret, se met volontairement en scène, faute de mieux. « Je n’ai pas trouvé meilleur modèle », s’amuse-t-il non sans dissimuler un rire gêné.
La photo est devenue depuis quelque temps l’outil complice qui lui permet de mettre en forme ses idées. Et celles qui l’ont assailli entre le 17 mars et le 11 mai 2020 ont trouvé des échos tellement favorables et enjoués que le livre Un jour, un carton, est né, témoin précieux de cette étrange période.
Publiant chaque jour sur Instagram ses aphorismes picturaux, Philippe Hérard, noue de multiples conversations avec des inconnus : « J’avais plusieurs centaines de likes par jour, les gens m’envoyaient des messages pour me remercier. Je trouvais cela dingue. Il y avait tellement d’échanges alors que nous étions tous si isolés ». Parmi, ses followers, un galeriste à Florence (Italie) le contacte et l’invite à venir exposer et à réaliser des collages in situ, l’autre grande spécialité de cet artiste qui installe ses scènes de vie absurdes dans les rues depuis une dizaine d’années.
Quand le deuxième confinement est arrivé, coincé à Paris en pleine préparation d’une exposition, il a tiré profit de sa sortie quotidienne dans un rayon d’un kilomètre pour tapisser quelques murs. Durant les quelques mois de liberté retrouvée, il a approfondi la thématique de l’enfermement et plutôt que de laisser dormir ses nouvelles œuvres, il a préféré en adapter quelques-unes pour l’extérieur et donner ainsi un avant-goût de son expo « Cent Sortir ».
Les protagonistes sont de plus en plus confinés, du carton ou du mur seuls dépassent quelques bouts de corps : un bras, une jambe, des yeux, des mains… Il nous met littéralement en boîte dans des cartons-geôles. Même le chien se retrouve encartonné ! « Les silhouettes disparaissent, on ne voit plus que les membres qui essaient tant bien que mal de trouver des ouvertures. Cette nouvelle série est une espèce de suite, plus noire, quand même. Lors du premier confinement, j’étais en Province, il faisait beau, donc il y a des couleurs, des paysages, des situations. »
Selon un mode opératoire routinier, Philippe Hérard part faire son collage un jour sur deux, après avoir préparé la peinture sur papier kraft. « Un jour, je peins puis je pars repérer le bon endroit, le suivant, je colle. » Et comme à son habitude, toujours en plein jour, paradoxalement pour être plus tranquille, et échanger avec les passants interloqués et curieux d’en savoir plus… « La nuit, j’ai l’impression de faire quelque chose de mal, cela créé une tension désagréable ».
Et même s’il sait qu’il peut être verbaliser, le collage reste plus ou moins toléré car c’est totalement réversible. Jouissant d’une notoriété locale, il n’a d’ailleurs jamais déclenché les foudres de la police. « Cela dépend des arrondissements mais dans le 20e, ils sont plutôt cools. Et puis, il y a toute une économie qui s’est développée comme des street art tours. » Les commentaires les plus désobligeants ou étonnants proviennent le plus souvent du quidam qui vient à croiser l’artiste en action. Les renfrognés s’adoucissent vite dès lors que la scène prend vie.
A l’image de cette petite dame au cabas qui l’apostrophe : « Pourquoi vous faites ça, vous vous rendez compte du temps que ça va prendre pour l’enlever ? » Ce pince-sans-rire admet qu’il n’y avait jamais réfléchi. Une conversation s’engage alors. « Pendant 1h30, elle m’a raconté sa vie puis quand j’ai fini, elle est partie faire ses courses et elle était ravie, elle ne pensait plus du tout à l’enlever. »
Taiseux et plus habitué à l’ambiance feutrée des galeries qu’à la rumeur de la rue, 2009 marque un tournant dans sa vie. Après avoir été lâché par ses deux galeries, il a décidé d’aller faire prendre l’air à ses toiles. C’est comme ça qu’il a choisi la technique du collage et a commencé à vadrouiller dans son futur bastion et à se faire connaître. Avec le recul, Philippe Hérard sait que le fait d’investir l’espace public a modifié son approche de la peinture en atelier. « Dans les rues, on est confronté aux autres. On ne demande pas la permission et il y a un contact direct. Cela m’a vraiment donner envie de raconter des histoires et non plus seulement faire de la peinture très personnelle. » Ce mordu d’humour noir, initié par un grand frère à Hara-Kiri, Métal Hurlant puis Serre, Franquin ou Roland Topor, aurait adoré jouer avec les mots, mais il dit ne pas savoir. Alors c’est avec les pinceaux, les contextes et les affres du quotidien qu’il s’amuse à peindre des blagues existentielles. Et c’est déjà pas mal et surtout très beau à voir.
POUR CONTEMPLER SON ART :
–Ses collages dans tout le quartier de Belleville
– L’expo « Cent-Sortir » au Cabinet d’amateur à Paris, jusqu’au 10 janvier
- – « S’échapper » chez Art Can Gallery à Marseille jusqu’au 30 janvier
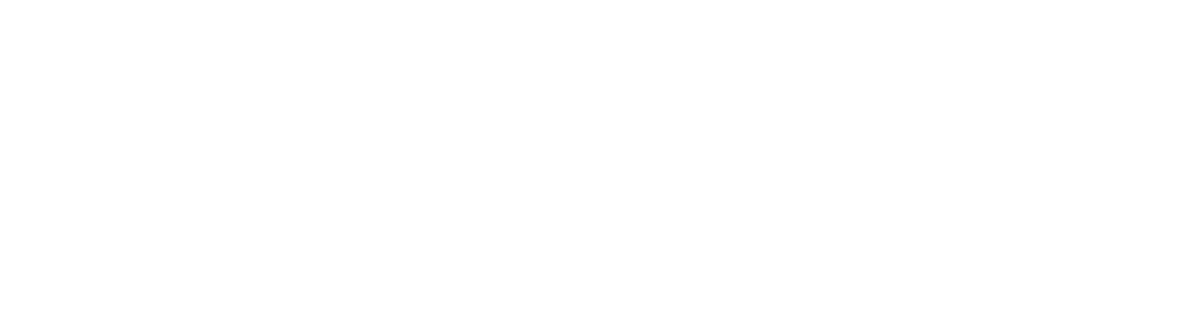
.jpg)
.jpg.webp)
Identifiez-vous! (c’est gratuit)
Soyez le premier à commenter!