.jpg)
Marseille et le mirage du queeristan
« C’est une ville qui ne laisse personne indifférent. Tu peux la détester et l’aimer en l’espace d’une soirée. »
C’est un fabuleux week-end de juin, avant l’arrivée massive des touristes. Mon ami·e Audrey et un couple de potes, Mathilde et Oriana sont venu·es me rendre visite à Marseille. On choisit de passer la soirée dans un bar queer-friendly de la rue de Lodi, la Mer Veilleuse, à quelques encablures du Cour Julien. Juste avant de démarrer un déhanché endiablé sur des sons new wave, Mathilde se confie : “Je me suis senti·e relativement safe à Marseille, je dois avouer que je ne m’attendais pas à ça.” Pour une personne queer qui vit à Berlin, c’est loin d’être un détail.
Marseille doit rougir, elle est si flattée depuis quelques années. Désignée comme un nouvel eldorado queer dans la presse, elle est aussi devenue la “nouvelle capitale de la France”. En 2020, Barbie(e)turix titrait : “Marseille, le Queeristan & la Pride” et ajoutait : “Marseille ! Nouvel eldorado du tout Paris queer”. En février de cette année, Têtu parlait aussi de Marseille comme du “bon coin queer au soleil”.
À la recherche de ma ville queer
Ibrahim s’est justement installé à Marseille, il y a un an et demi, à la recherche d’un terrain militant queer plus intersectionnel. Juste avant, il vivait Berlin : « J’avais fait le tour de la ville et ça manquait de diversité. Marseille est une ville hyper belle et je pense que je suis tombé au bon moment. La ville est anarchiste et révolutionnaire. Il y a un climat d’anticapitalisme qui m’a beaucoup plu. »
À Berlin, Ibrahim, aussi connu sous l’alter-ego Yanaka, a performé dans plusieurs Ball. Et l’envie de reconstituer cette culture dans la cité phocéenne le titillait. Le projet s’est concrétisé le 9 juillet avec la détermination de plusieurs ami·es de l’association The Baobab Project lors d’une mini-ball explosive au Makeda, un club situé à cinq minutes chrono de la place de La Plaine. Dès le départ, les organisateur·rises ont mis un point d’honneur à expliquer les diverses catégories aux participant·es et curieux·ses présent·es. La scène s’est construite pour et autour de Marseille. « On s’est dit qu’on allait donner à Marseille les clés pour comprendre la ballroom. » précise Yanaka qui ne voulait pas « venir en mode colon. »
Née à Harlem dans les années 20, cette sous-culture artistique et politique se joue en vase clos et safe pour les communautés LGBTQ+. Les participant·es doivent performer à l’issue de différents concours dont le but est finalement de parodier et détourner les codes de la société hétéronormative et des élites blanches. Dès la fin des années 1960, les communautés afro et latino-américaines new-yorkaises décident d’ouvrir leurs propres balls, où éclot le voguing en réaction au racisme omniprésent dans les balls.
.jpg)
Les LGBTQ+ en ligne de front des luttes phocéennes
Cet évènement était probablement la première ball organisée dans la ville, en dehors d’initiatives plus institutionnelles de la Friche de la Belle de Mai ou du MUCEM. Se visibiliser est un enjeu monstre qui demande de sortir des scènes alternatives. En juillet, s’est tenu pour une seconde édition, le festival Umoja. Créé pour des personnes queer, trans et afroqueer, c’est « le festival des minoritaires de la minorité » précise Paulo qui a cofondé le festival avec Erika. « Je suis un homme trans, PDx ,blanc, Erika est une femme noire afroqueer, rappeuse, beatmakeuse, lesbienne » ajoute-t-il. Iels ont organisé des ateliers, tables rondes et concerts entre les quartiers Nords et le centre-ville. Le Marseillais de naissance et de cœur résume ainsi le projet : « On s’intéressait à tous les artistes minorisés, qu’on ne voit jamais et qui ont du mal à atteindre les scènes professionnelles : les personnes queers racisées, les personnes trans, mais aussi les femmes, les artistes queers en général et les personnes racisées. »
Dans la nouvelle capitale française, on peut voguer entre différents lieux et espaces historiquement ou nouvellement LGBTQ+ comme La Mer Veilleuse et Le Pulse sur le Cour Ju, le Polikarpov au Vieux-Port ou encore le bar lesbien Aux 3G à la Plaine. Sur le site de ressources LGBTQ+, Big Tata, plus d’une cinquantaine d’associations et collectifs sont recensés à Marseille. C’est dix fois moins qu’à Paris et deux fois moins qu’en région lyonnaise. Ici, il n’y a pas de centre LGBTQ+ mais un centre d’archives, « Mémoire des sexualités », créé à l’initiative d’un citoyen Christian de Leusse. Les Phocéen·nes ont toujours lutté, en souterrain ou en plein air, et iels ne sont pas tous·tes hétéro·as.
Quand je pousse la porte des 3G, un vendredi en fin de journée, les personnes habituées du bar papotent jovialement en attendant l’arrivée de Sylvie, la cofondatrice des lieux. La sexagénaire a co-créé le bar en 1996, trois ans après la première Pride de la ville. Militante au sein d’Act-Up, elle y rencontre alors ses camarades de luttes. « On s’est dit qu’on voulait un endroit où on pouvait avoir un babyfoot, un flipper et rencontrer des femmes. Mais on était quand même ce qu’on était. C’est-à-dire […] antifasciste et antiraciste » explique la Marseillaise. Elle nous parle de la grande époque de la lutte contre le Front national, d’un temps où le local d’Act-Up était dans le quartier de La Plaine et où le SIDA assassinait la jeunesse vibrante de Phocée : « On avait ce côté rebelle d’Act-Up, on s’était enchaîné à l’hôpital de La Conception, on avait balancé du sang à la Canebière… » Et c’est bien grâce au terreau militant du quartier de La Plaine et du Cour Ju que le bar lesbien trouve sa place dans l’espace public. « Le patron du bar au-dessus nous servait un peu de protecteur. Et même encore maintenant avec le snack en face, à force de se voir, on a créé des liens. C’est le côté : « t’es de la rue, t’es du quartier » » renchérit Sylvie.
.jpg)
Capte-la si tu peux : Marseille, une friche géante et unique
Et le quartier de prédilection de l’imam Ludovic-Mohamed c’est la populaire Belle de Mai. Il y a ouvert son institut religieux, Calem, un lieu inclusif de prière mais aussi de recherche, de formations et d’échanges sur l’islam et l’intersectionnalité. « C’est un peu comme chez Mcdo, tu viens comme t’es. […] Il y a beaucoup de choses qui sont possibles à Marseille qui ne seraient pas possibles ailleurs » plaisante-t-il. Amoureux de la plus vieille ville de France, le docteur en sciences humaines et sociales y a trouvé il y a plus de vingt-cinq ans un espace pour s’exprimer librement, plus librement qu’à Londres, Paris ou Berlin. « C’est moins performatif et standardisé qu’ailleurs ». Et d’ajouter : « Ne serait-ce qu’au niveau de la gentrification, ça ne marche pas vraiment. Un peu, ils essaient, ils ont fait leur espèce de triangle d’or bis, les touristes font leur petit tchoutchou avec le petit train puis ils repartent sur leur paquebot. […] Le plus intéressant à Marseille c’est l’underground, ce n’est pas l’institutionnel. »
Celui qui est souvent désigné dans les médias comme le « premier imam gay de France » se méfie de l’émulation autour de sa ville… mais lui fait confiance : « Ce sont les Marseillais et les Marseillaises qui font la vie culturelle à Marseille. Et ça c’est un peu une résurgence et un héritage de la ségrégation qui a eu lieu pendant des décennies. »
Lua a aussi trouvé la paix auprès de la Bonne Mère. Elle est co-fondatrice du collectif queer Qoeur Qoeur qui organise des ateliers et évènements pour valoriser et transmettre les savoirs profanes de la communauté queer. Celle qui a grandi sur la Côte d’Azur, a aussi vécu un temps dans le Nord de la France, à Paris : « Je me suis toujours identifiée en tant que personne bisexuelle, les questions de transidentité sont arrivées plus tardivement, un ou deux ans avant de partir de Paris. À Marseille j’ai rencontré des queers et des personnes trans, et j’ai pu avoir accès à une communauté et à des espaces où j’étais écoutée et comprise. Ça m’a permis de faire ma transition. »
Extrême jusqu’au bout, la cité phocéenne affiche des écarts de richesse records. Un quart des Marseillais·es sont pauvres mais les habitant·es des quartiers sud sortent les œillères et les clôtures hermétiques pour leurs chics zones résidentielles. Pour aider les plus précaires c’est souvent l’organisation citoyenne qui prend le relai. « Le fait que ce soit une ville encore un peu accessible financièrement permet à beaucoup de personnes qui sont rejetées de plein d’endroits de trouver une place » justifie Lua. La solidarité se joue dans la rue et dans les squats mais aussi en virtuel où on se refile sur Facebook, Signal et autres, des bons plans coloc queer.
.jpg)
Marseille queer ? Work in progress
Pour prendre le pouls de la visibilité queer de la ville, j’ai beaucoup déambulé dans des quartiers militants et historiquement plus alternatifs. Mais Marseille est une très grande dame de 240 km². Et l’eldorado queer semble bien loin quand les discriminations et agressions LGBTQ+phobes font irruption. Se créer des espaces safe où les communautés peuvent s’approprier sans crainte l’espace public, ça demande du temps, de la prévention et toujours plus de luttes. « Quand je suis arrivé, j’étais dans le 3e arrondissement, juste après la gare Saint-Charles, […] là-bas être queer c’était beaucoup plus difficile que de vivre maintenant du côté de la Plaine ou du Cour Julien » regrette le Néo-Marseillais Ibrahim.
111 villages unifiés pour créer la ville tentaculaire de Marseille, c’était osé. Vivre ici c’est un peu cohabiter avec des personnes qui portent des valeurs à l’opposé des tiennes, c’est jouer les funambules. Lua abonde en ce sens et met aussi en garde les personnes qui viendraient à Marseille simplement pour le cool ou pour gentrifier : « Ce qui fait un truc queer, ce n’est pas simplement des coupes de cheveux bizarres, et des soirées hyper hype. C’est vraiment une culture des minorités. » Sans compter la difficulté d’imposer ses scènes alternatives au national. « La France est ultra centralisée, quand on fait des choses sur Marseille, c’est dur de se visibiliser » regrette Paulo.
Même dans la communauté, des scissions ont eu lieu. Sylvie évoque un débat houleux entre une génération universaliste plus âgée et une autre plus jeune et plus intersectionnelle. En cause, le Wall of Fame qui trône à l’entrée des 3G. Des portraits photos de diverses personnalités sont affichées de Jodie Foster à Alice Coffin en passant par… Caroline Fourest. Les féministes intersectionnelles du bar ont dénoncé les prises de position islamophobes et racistes du personnage quand les universalistes ont préféré défendre la visibilité lesbienne qu’elle portait dans les années 2000. Le portrait est resté. Quitte à ce que certain·es désertent les lieux pour en chercher de nouveaux où prendre leur place.
Le grand port méditerranéen n’est peut-être pas une utopie queer mais ce n’est pas pire qu’ailleurs pour Ludovic-Mohamed qui s’y sent à l’aise : « Je ne me sens pas discriminé, pointé du doigt, catégorisé. Je me sens limite faire partie de la majorité, c’est très bizarre. Je ne me sens pas une pièce rapportée. Ce que je me suis toujours senti être ailleurs. » C’est un lieu de passage depuis deux bons millénaires qui n’a jamais empêché certain·es de vouloir s’y ancrer et Ibrahim n’échappe pas à cette tentation. Le jeune épris déclame : « Je ne pense pas qu’il y ait de véritable eldorado. Je pense qu’on construit son eldorado autour des gens qu’on aime, autour de sa nouvelle famille, de sa nouvelle communauté. […] Et Marseille c’est vraiment beau, c’est intense, c’est le chaos. C’est une ville qui ne laisse personne indifférent. Tu peux la détester et l’aimer en l’espace d’une soirée. »
.jpg)
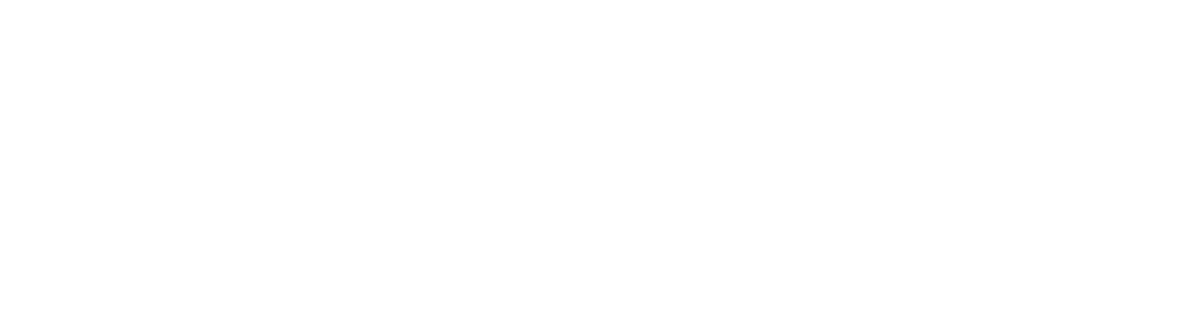
Identifiez-vous! (c’est gratuit)
Soyez le premier à commenter!