.jpg.webp)
Ma relation amour-haine avec les antidépresseurs
Ils soignent mon anxiété depuis 10 ans, et j’ignore si je pourrai un jour vivre sans.
Avant de raconter mon histoire, j’aimerais rappeler que chaque personne est différente et que mon vécu ne fait pas de moi une professionnelle de la santé. Si vous avez besoin de conseil sur votre santé mentale, la prise ou l’arrêt d’antidépresseurs, consultez un.e médecin.
J’avais 12 ans la première fois que j’ai fait une crise de panique.
J’étais avec d’autres élèves dans notre classe d’anglais. Soudainement, je me suis mise à avoir la nausée et à crever de chaleur. J’étouffais. Je me suis empressée d’avertir l’enseignant, et ma mère est venue me chercher à l’école une demi-heure plus tard.
Une fois à la maison, couchée dans le lit de mes parents – l’endroit le plus sécuritaire au monde à mes yeux –, je me sentais en pleine forme. Tout sentiment d’inconfort s’était volatilisé. J’ignorais ce qui venait de se passer.
Évidemment, l’expérience s’est répétée.
Au collège, j’étais régulièrement figée de panique au fond de la classe, convaincue que je n’arrivais plus à respirer. Il n’y avait qu’à mon prof de math Pierre que j’osais demander de sortir. Puis, ça passait.
Je crois que c’est cette année-là que ma mère m’a amenée voir une psy pour la première fois. J’avais la chance d’avoir des parents ouverts d’esprit et informés au sujet de la santé mentale, mon père étant un grand anxieux.
Tout ce que je me rappelle, c’est que la psychologue m’avait demandé ce que j’aimais. « Les dauphins », avais-je répondu, nommant la seule chose qui m’était venue en tête. Elle m’avait donc suggéré de penser aux dauphins quand j’avais de la difficulté à respirer. Pas le truc le plus efficace du monde, je vous dirais.
Elle m’avait aussi donné un CD de méditation guidée, que j’écoutais avec ma mère avant de me coucher, toutes les deux étendues dans mon petit lit simple. Ça, ça fonctionnait mieux.
Le fait qu’une professionnelle ait identifié que ces moments où je croyais être en train de mourir étaient en réalité des crises de panique avait suffi à atténuer grandement mon anxiété à cette époque. J’avais compris que je ne courais aucun danger, contrairement à ce que mon esprit voulait me faire croire. Mes crises de panique ont même presque complètement disparu dans les années qui ont suivi.
Changement = anxiété
Puis, je suis arrivée au lycée et tout a recommencé. Sauf que c’était cent fois pire. Avec le recul, je réalise que ce sont les périodes de grands changements qui déclenchaient mon anxiété – et Dieu sait qu’il y en a, du changement, quand on est ado et jeune adulte –, mais à ce moment-là, je ne comprenais pas du tout ce qui m’arrivait.
Je ne faisais plus de crises de panique passagères : j’étouffais 24 heures sur 24.
Je ne faisais plus de crises de panique passagères : j’étouffais 24 heures sur 24. Une douleur aiguë au cœur m’empêchait de fonctionner normalement; j’avais l’impression d’avoir le poids d’un éléphant sur la poitrine à toute heure de la journée.
Même si je l’ai vécu pendant des années, je peine à comprendre comment notre cerveau peut provoquer des sensations corporelles aussi puissantes. Mais croyez-moi, même si on nous répète que « c’est dans notre tête » (probablement la chose que les personnes anxieuses sont le plus soulées d’entendre), quand on ressent ces symptômes psychosomatiques, ils sont bien réels. C’est très, très fort.
J’ai commencé à aller chez le médecin régulièrement, convaincue que je souffrais d’un grave problème au cœur ou aux poumons. Et quand le médecin m’assurait que j’étais en parfaite santé, j’étais persuadée qu’il se trompait, qu’il n’avait pas fait les bons tests, qu’il allait trop vite et qu’il n’écoutait pas ce que je lui disais. C’est devenu un cercle vicieux : plus j’allais chez le médecin, moins il me prenait au sérieux et plus j’étais convaincue que j’étais malade.
En fait, nous avions tous les deux raison. J’étais bien malade, mais rien qui pouvait ressembler à un cancer du poumon ou à un trouble cardiaque. J’aurais aimé que mon médecin prenne le temps de m’expliquer les options qui s’offraient à moi plutôt que de me renvoyer chez moi en me disant que ce n’était « que » de l’anxiété.
J’ai vu deux ou trois psys, mais même si la thérapie m’aidait à être un peu moins inquiète de mon état, les symptômes physiques étaient toujours là. Finalement, lors d’un énième rendez-vous, mon médecin m’a diagnostiqué un trouble d’anxiété généralisée et m’a proposé d’essayer les antidépresseurs. J’ai commencé à prendre la dose la plus faible de Seroplex. J’avais 18 ans.
La lumière au bout du tunnel
Malheureusement, mon état a continué de dépérir alors que je commençais l’université dans une ville où je ne connaissais personne. J’étais complètement isolée, je passais mes soirées à pleurer. Je me suis même retrouvée à l’urgence un soir où j’étais convaincue, encore plus que d’habitude, d’être en train de mourir. J’ai dû me rendre à l’évidence : ce médicament n’était pas fait pour moi.
Presque du jour au lendemain, j’allais mieux; beaucoup, beaucoup mieux. Je n’étouffais plus. Plus de douleur au coeur. Plus de pensées obsessives au sujet de ma santé.
Puis, j’ai changé de médication et ma vie a changé du tout au tout. Je suis passée de Seroplex à Effexor (ce n’est pas parce que le premier n’a pas fonctionné pour moi qu’il ne fonctionnerait pas pour quelqu’un d’autre : on réagit tous et toutes différemment aux médicaments), tout en poursuivant la psychothérapie.
J’ai commencé à parler aux gens dans mes cours et je me suis fait de très bon.ne.s ami.e.s. Je sortais avec eux tous les jeudis, je revivais. Presque du jour au lendemain, j’allais mieux; beaucoup, beaucoup mieux. Je n’�étouffais plus. Plus de douleur au coeur. Plus de pensées obsessives au sujet de ma santé. Tout ça presque sans que je le réalise.
Et c’est comme ça depuis.
Aujourd’hui, j’ai 28 ans, je prends des antidépresseurs depuis 10 ans, et je vais très bien. Je ne ressens presque plus jamais de symptômes physiques d’anxiété, et lors des rares occasions où ça m’arrive, je suis en mesure de les contrôler.
Pour toujours ?
Si les médicaments m’ont littéralement sauvé la vie, pourquoi alors est-ce que le titre de cet article parle d’une relation amour-haine ?
Tout d’abord, à cause des effets secondaires. Je suis assez chanceuse, j’en ai relativement peu. J’ai légèrement moins de libido qu’avant (mais j’ai toujours des orgasmes contrairement à plusieurs personnes), j’ai l’impression d’avoir moins de mémoire et de penser moins clairement qu’avant, j’ai les cheveux plus minces… Et ce qui me dérange le plus : j’ai pris 15 kilos.
Quand je me suis fait prescrire des antidépresseurs à 18 ans, j’aurais aimé que mon médecin m’explique à quel point il peut être difficile, voire impossible, de les arrêter.
Je vous entends déjà me dire (comme tout le monde autour de moi), que prendre 15 kilos en 10 ans, c’est assez normal : on vieillit ! Mais je connais mon corps et je sais que mon métabolisme a complètement changé, mon appétit aussi. Je continue de prendre du poids année après année, même si je bouge beaucoup plus et que je mange beaucoup mieux qu’avant. Je sais, ça peut sembler un petit prix à payer pour avoir une bonne santé mentale, mais ça reste parfois difficile à accepter pour moi.
L’autre facteur qui me dérange, c’est que je suis incapable d’arrêter les antidépresseurs (comme c’est le cas de bien des gens). Et ça m’inquiète de devoir en prendre toute ma vie. Je vois tous les changements que les antidépresseurs ont provoqués sur mon corps, et je me demande quels seront les effets à long terme. La science n’en sait encore que très peu à ce sujet. J’aimerais aussi avoir des enfants d’ici quelques années, et je n’aime pas l’idée d’une grossesse sur les antidépresseurs – un sujet controversé qui pourrait faire l’objet d’un article distinct.
Quand je me suis fait prescrire des antidépresseurs à 18 ans, j’aurais aimé que mon médecin m’explique à quel point il peut être difficile, voire impossible, de les arrêter, surtout si on les prend pendant plusieurs années. Tout particulièrement Effexor, dont le sevrage serait l’un des plus éprouvants. Selon un article de l’Associated Press, les plaintes de patient.e.s concernant les effets négatifs de l’arrêt de ce médicament sont si nombreuses que plusieurs médecins évitent désormais de le prescrire. Les forums sur le web pullulent de témoignages de gens qui tentent de diminuer leur dose ou d’arrêter complètement et qui se retrouvent avec des symptômes de sevrage débilitants, parfois à long terme : fatigue, nausée, étourdissements, maux de tête, nervosité, cauchemars, tremblements… et les fameux « brain zaps », cette sensation de petits chocs électriques au cerveau (fun, I know!).
Pour ma part, j’ai essayé d’arrêter à trois reprises en dix ans (toujours en suivant les recommandations de mon médecin), et chaque fois, après environ un mois de maux de tête quotidiens, je finis par abdiquer.
Il est urgent de mettre plus qu’un pansement sur la crise de santé mentale qui existait déjà bien avant la pandémie et qui ne fait que s’aggraver depuis.
Bref, ce que je retiens de mon expérience, c’est que les antidépresseurs ne devraient jamais être prescrits en seulement quelques minutes. Lorsque j’ai commencé à en prendre, j’aurais souhaité que l’on m’informe mieux de leurs effets positifs comme négatifs, et que l’on m’offre un suivi après une courte période d’essai. D’ailleurs, des psychiatres anglais suggéraient récemment « une pratique de prescription plus prudente, avec des antidépresseurs administrés à moins de patients et pour des périodes plus courtes ».
Plus largement, il est urgent de mettre plus qu’un pansement sur la crise de santé mentale qui existait déjà bien avant la pandémie et qui ne fait que s’aggraver depuis. Les médicaments sauvent des vies, mais pour qu’on vienne collectivement à bout de ce mal-être généralisé, ça ne peut pas être notre seule arme. Il faut changer nos façons de vivre, à commencer par le rythme effréné que l’on s’impose, et privilégier la prévention.
En attendant, je vais continuer de prendre mes petites pilules roses et d’être reconnaissante qu’elles me permettent de vivre ma vie pleinement. Peut-être qu’un jour, j’arriverai à m’en passer. Ou peut-être pas, et c’est pas grave.
*****
Si vous avez besoin d’aide, des ressources existent. Vous n’êtes pas seul.e.
SOS crise (association Les transmetteurs)
Ecoute et orientation pour obtenir de l’aide pour toute personne inquiète ou angoissée, par des professionnels de la santé, du social ou de l’éducation à la retraite et bénévoles. Service gratuit et anonyme, seuls le prénom et le code postal sont demandés.
0800 19 00 00 (7j/7 9h-19h)
Vous pouvez aussi composer le 15 ou une ligne d’écoute comme Suicide écoute (01 45 39 40 00) ou SOS amitié (09 72 39 40 50).
Identifiez-vous! (c’est gratuit)
Soyez le premier à commenter!
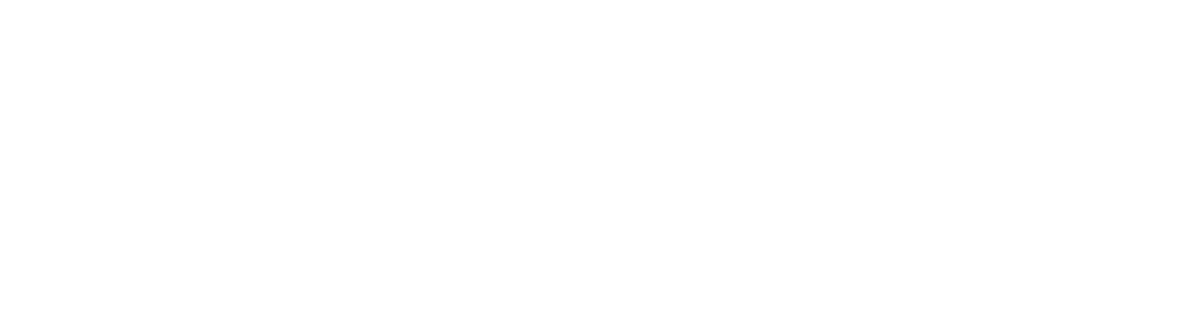
.jpg)
.jpg.webp)