.jpg.webp)
Liberté, égalité, sororité
Quand on m’a proposé d’écrire sur le concept de sororité, j’ai tout de suite accepté tant la notion traverse aujourd’hui nombres de mes réflexions. Pourtant, j’ai mis du temps à l’écrire. Quelque chose demeurait confus. Qu’était la sororité pour moi ? Quelle réalité pouvait-on révéler à partir de la valorisation de ce terme ? Pourquoi, malgré mes affinités avec ce dernier, quelque chose comme la peur d’un replis communautariste demeurait ? Et c’est ainsi qu’en m’attaquant à définir la sororité, je me suis trouvée face à la nécessité de l’éclairer pour moi-même, et à déconstruire une fois de plus l’histoire d’une individualité.
« Provenant du latin soror, sœur ou cousine, le mot désigne au Moyen-Âge les communautés religieuses de femmes… ». Non, plutôt que de vous servir l’historiographie du mot — par ailleurs déjà bien documentée ici, ou là — je vais partir d’une anecdote personnelle. Celle de mon premier séminaire à Paris VIII au cours duquel l’enseignant s’était adressé à la salle d’un tonitruant « Bonjour à toutes ! ». Interloquée par cette évidente faute de français — l’assemblée, majoritairement féminine, comportait un nombre visible d’étudiants masculins — j’avais porté une attention particulière à son discours. Et vite compris que ce « toutes » était énoncé consciemment, puisqu’il réitérait « l’erreur » à chaque adresse au groupe.
De faire corps à partir d’une expérience commune. Voilà ce qu’est pour moi la sororité.
À la sortie, je me souviens avoir interpellé mes camarades pour vérifier que j’avais bien entendu. Oui, j’avais bien entendu. Nous avions toutes entendu. On ne se connaissait pas, mais je me rappelle de l’énergie qui présidait à ce premier échange : chacune se remémorait l’apprentissage de la fameuse règle du « masculin qui l’emporte sur le féminin » et la révolte ressentie petite fille. Qui, par ce simple « Bonjour à toutes », était enfin entendue. C’était l’une des premières fois que je partageais avec des inconnues quelque chose de si singulier. Nous nous parlions en amies, nous échangions sur le traumatisme intellectuel qu’avait été l’intégration de cette règle sexiste. Nous réfléchissions à la manière dont la langue est politique, à sa force performative. Voilà qu’avec ce que l’Académie considérait comme une faute grossière, ce professeur avait fait apparaître l’invisibilisation que nous subissions toutes depuis l’enfance[1] et nous avait permis d’entrer en contact. De faire corps à partir d’une expérience commune. Voilà ce qu’est pour moi la sororité.
Cette première impossibilité à partager une blessure si profonde a eu des répercussions sensibles sur mon rapport aux femmes victimes de violences.
En rentrant chez moi, je me souviens d’avoir ressenti un sentiment de reconnaissance associé à un malaise grandissant. La grammaire n’était pas le seul endroit où nous pourrions avoir vécu la même chose… Mais avais-je déjà connu cette communion avec mes sœurs ? Non, bien au contraire. Et je me plongeai dans un souvenir autrement plus traumatique, celui du viol que j’avais subi à la sortie de l’enfance. Survenu dans ma dernière année d’école primaire, j’en avais parlé quelques mois plus tard à mon arrivée au collège aux filles autour de moi. Je me souviens précisément de la langue que j’avais employée : clinique tout en étant démesurée (comment être à la mesure de l’expérience ?). Tout sonnait faux, à la fois parce que je ne savais pas avec quels mots décrire ce que j’avais vécu et parce que cette réalité était inaudible. J’aimerais dire que j’ai trouvé pourtant une oreille amie, mais ce serait mentir. Je n’ai rencontré à l’époque que de l’indifférence. Pas même du déni, de l’indifférence. Je m’enfermai dans les toilettes pour pleurer des larmes théâtrales. J’en ressortis les yeux rougis pour m’entendre dire « Ah, ma pauvre » tandis que l’on continuait à s’écharper sur un vol de chouchou. Je me demande aujourd’hui si cette indifférence de la part des filles qui m’entouraient ne provenait pas de la trop grande familiarité de mon récit avec ce qu’elles avaient pu vivre, associée à la pudeur de notre âge ?
Et c’est ainsi que, alors même que j’étais victime, ma première réaction au moment de me too fut la même que celle de Catherine Deneuve.
Cette première impossibilité à partager une blessure si profonde a eu des répercussions sensibles sur mon rapport aux femmes victimes de violences. J’ai porté de longues années ma résilience face à ce viol comme un trophée intime, car j’avais dû me construire sans la solidarité de celles qui comme moi étaient des filles, puis des femmes. J’étais entrée, sans en avoir conscience, dans une compétition morbide avec les autres victimes de viols. Moi, je m’en étais sortie (vraiment ?) quand d’autres avaient sombré. Je faisais de cette force la marque d’une élection. Puisque je n’étais pas faible comme elles, celles qui portaient leur traumatisme comme un étendard, celles qui tentaient par tous les moyens d’être entendues et qui semblaient ne plus devoir vivre sans obtenir cette écoute. Et c’est ainsi que, alors même que j’étais victime, ma première réaction au moment de me too fut la même que celle de Catherine Deneuve.
Parce que j’étais si jeune au moment des faits, je n’avais pas pu comprendre que ce vécu était autant individuel que politique.
Rapidement la déferlante de témoignages a changé en profondeur mon rapport à tout ça. Nous étions une communauté. J’ai eu honte de moi. Et puis j’ai tenté de dénouer les fils et de comprendre : jusqu’à quel point étais-je responsable de mon aveuglement ? Parce que ma parole avait été réduite au silence, j’avais cru que ce que j’avais vécu était avant tout personnel. Parce que j’étais si jeune au moment des faits, je n’avais pas pu comprendre que ce vécu était autant individuel que politique. Et là se dénoue une nouvelle fois le sens qu’à pour moi la sororité, et qu’Adèle Haenel a si justement mis en lumière dans son témoignage : derrière les traumatismes individuels qu’engendre cette société patriarcale se déploie une oppression systémique qui est politique.
Cette société a tout intérêt à laisser les victimes isolées face à leur destin singulier, plutôt que de les autoriser à faire corps, à s’unir, pour trouver ensemble un chemin vers l’autonomie. Dès lors que l’on comprend que notre expérience de femme est une expérience commune, nous pouvons la mettre en perspective et la dénoncer de manière politique. La sororité est pour moi un manifeste qui nous permet de passer du statut de victimes isolées, et donc affaiblies, à des individus émancipés qui prennent leur destin en main et se battent contre un système de domination. Et d’affirmer par exemple que non, il n’est pas anodin d’apprendre à l’âge de huit ans que le « masculin l’emporte sur le féminin » quand on sait qu’une femme sur trois sera victime au cours de sa vie d’une agression sexuelle.
Ainsi je réfute les discours qui pensent la sororité comme la défense de l’intérêt particulier des femmes, contre la fraternité qui porterait des valeurs universelles. La sororité n’est pas la défense de l’intérêt particulier mais l’affirmation du partage d’une expérience commune : celle d’être une femme dans une société patriarcale.
Partageons nos savoirs, nos expériences, créons d’autres récits où les femmes sont libres et indépendantes. Réactivons les figures des femmes autonomes.
La reconnaissance de cette communauté d’expérience pose un cadre à partir duquel il devient possible de nommer — et donc, de lutter contre — un système d’oppression.
La sororité permet de rendre visible dans le langage une réalité partagée et crée ainsi un espace de réparation où le vécu individuel est enfin pris en compte et mis en perspective.
Elle est enfin un outil grâce auquel les femmes peuvent se libérer des récits au sein desquels elles n’ont pas de place.
Car le combat féministe est aussi celui de l’invention de nouveaux imaginaires. Pour le mener à bien, nous avons besoin de nous réapproprier un langage qui fut trop longtemps celui de la pensée patriarcale[2], d’activer des mots qui rendent compte de ce que nous vivons. Oui, des mots qui nous redonnent notre puissance.
Partageons nos savoirs, nos expériences, créons d’autres récits où les femmes sont libres et indépendantes. Réactivons les figures des femmes autonomes comme celle de la sorcière dont Mona Chollet retrace la trajectoire dans son dernier ouvrage Sorcières. Relisons La théorie de la fiction panier d’Ursula K. Le Guin qui nous enjoint à raconter l’histoire de celles qui plantent les graines et tissent les paniers plutôt que les récits de violence. Inventons-nous un monde à notre mesure, loin des théories virilistes sur lesquelles repose le capitalisme patriarcal qui nous oppresse tout en détruisant notre environnement. Et entonnons ensemble un nouveau chant: Liberté ! Égalité ! Sororité !
.jpg.webp)
***
[1] Et ce, que ce fait de langue en soit la cause ou la conséquence
[2] Cependant, au sein de ces imaginaires, il n’est pas interdit aux hommes d’enfourcher eux-aussi leurs balais pour déconstruire le monde dont ils sont victimes et qui fait d’eux des bourreaux…
Identifiez-vous! (c’est gratuit)
Soyez le premier à commenter!
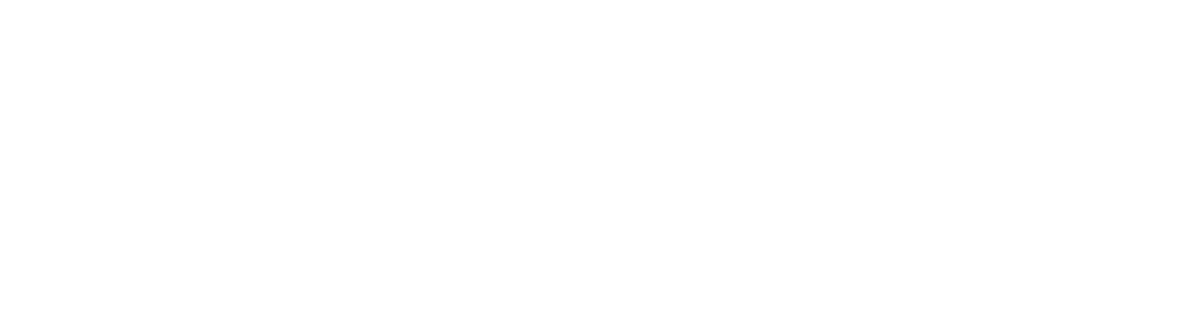
.jpg)
.jpg.webp)