.jpg)
Le nouveau business des cuisines virtuelles : à l’ombre des dark kitchens
Ces cuisines sans salle et sans clients, optimisées pour la livraison à domicile, ont vu leur nombre se multiplier depuis le début de la pandémie et la fermeture des restaurants traditionnels. À l’ère du plat à emporter, les plateformes ont-elles réussi à définitivement uberiser le monde de la restauration et orienter le libre arbitre de nos papilles ?
Au numéro 12 de la rue Palouzié, à Saint-Ouen, vous ne passerez pas la porte du hangar sans un sac isotherme à la main ou en bandoulière. Le vigile – costaud et peu loquace – n’hésitera pas à s’enquérir de votre présence sur les lieux si vous trainez un peu trop longtemps sur le trottoir d’en face, hypnotisé par le ballet incessant des livreurs casqués et motorisés. Les caméras de surveillance, stratégiquement placées au-dessus de la scène, finiront de vous faire passer le message : circulez, il n’y a rien à voir.
Pourtant, c’est entre ces quatre murs rigoureusement protégés que se cache la dernière lubie et manne financière de la plateforme de livraison Deliveroo : une dark kitchen, soit un espace hybride mi-cuisine, mi-laboratoire, implantée sur plus de 700 mètres carrés et optimisée pour la préparation de plats livrés à domicile. Inaugurée en 2017 par l’entreprise britannique – qui n’a pas souhaité répondre à nos questions –, le site abrite aujourd’hui les cuisines de plusieurs enseignes bien connues des foodies parisiens : Le Petit Cambodge, Five Guys, Pierre Sang Express, Tripletta, PNY… Pour une gourmande commission de 40 % sur leurs recettes, le géant de la livraison les autorise à cuisiner leurs burgers et autres pizzas sur place, sans charge de loyer et avec la perspective de toucher de nouvelles zones géographiques. Sauf qu’ici, pas de tables, pas de serveurs et pas de clients. Seulement quelques cuistots, des livreurs et des sacs en papier kraft.
Un local, trois « restaurants »
Le phénomène est apparu aux États-Unis, évidemment. Et si les dark kitchens – ou cuisines fantômes en français – existent depuis quelques années, la pandémie leur a fourni le terreau idéal pour se développer à vitesse grand V. Avec un modèle économique optimisé et s’exonérant de l’accueil du public ou d’une équipe en salle, le concept de ces cuisines aveugles a séduit quelques chefs et restaurateurs forcés de s’adapter et inquiets de ne pas voir leurs salles rouvrir avant l’été, comme Arnaud Chassaing et Nathan Levy. Dans quelques semaines, les deux restaurateurs – déjà à la tête du bistrot marseillais le Trois Quarts – ouvriront leur première cuisine exclusivement destinée à la livraison. « Le restaurant est resté fermé pendant les deux confinements et nous avions besoin d’un nouveau projet pour trouver une autre source de stimulation et de revenus », explique Nathan au téléphone. La nouvelle structure proposera une cuisine méditerranéenne livrée sous forme de sandwich ou de bol, « avec la même qualité de produits qui a fait le succès du Trois Quart », assure le restaurateur.
Mais ce sont surtout les entrepreneurs qui ont flairé la bonne affaire : en 2020, les Français ont plus que jamais fait appel à la livraison de repas, en augmentant le trafic de plus de 47 % sur les plateformes tels qu’Uber Eats, Just Eat ou Deliveroo. Depuis, les dark kitchens fleurissent dans les grandes villes et leur périphérie, qu’elles soient pilotées par des grands noms de la Foodtech, des startups et leurs investisseurs – Not So Dark, Taster, StreetLab… – ou des indépendants qui cherchent à se faire une place au soleil. De quoi susciter toutes les convoitises sur un marché naissant et dont les pratiques restent encore obscures pour la plupart des consommateurs.
Car outre celles de restaurateurs soucieux de transparence, nombre de ces cuisines exclusivement tournées vers la vente en ligne aiment à se faire passer pour des lieux de restauration « traditionnels » en laissant croire à leurs clients que derrière chaque nom d’enseigne se trouve un restaurant physique. En réalité, la majorité des dark kitchens sont essentiellement des sites de production, où plusieurs styles de cuisines – japonaise, coréenne, italienne, américaine – cohabitent sous des marques différentes.
« On cuisine trois marques virtuelles dans ces 30 mètres carrés », indique Jeanne* en poussant la porte du local. À l’intérieur de cet ancien restaurant de l’ouest de la capitale, l’installation est sommaire : un plan de travail, des fourneaux, un frigo à boissons et la sacro-sainte tablette, pour recevoir les commandes en ligne. Du dehors, impossible de deviner ce qui se cache derrière les baies vitrées, bâchées par du plastique. Sur la devanture, seules trois petites affiches avec les logos des enseignes indiquent aux livreurs qu’ils sont arrivés à bon port.
C’est ici que, quatre jours par semaine, Jeanne s’installe en face de la tablette pour assurer ses services de « dispatch ». « Ce n’est pas très compliqué, je réceptionne les commandes et je les transmets aux cuisiniers. Pendant qu’ils les préparent, je remplis les sacs de serviettes, de sauces, de boissons et je referme le tout quand la bouffe est prête. Ensuite j’attends que les livreurs arrivent. » À ses côtés, deux cuistots s’occupent de la popote pour les trois restaurants virtuels que cette cuisine expédie aux quatre coins de Paris. « On a une marque de poulet frit, une de smash burgers et une autre de cuisine japonaise. Mais chacune d’entre elles a ses sacs et son logo, comme ça on ne se trompe pas au moment de l’emballage », énumère l’ancienne étudiante en graphisme, contrainte d’avoir dû se trouver un job alimentaire au début de la pandémie.
« En cinq minutes, la commande doit être prête et emballée »
Avec leurs photos alléchantes façon « food-porn » postées sur des comptes Instagram bien ficelés, les « restaurants » des employeurs de Jeanne font sensation sur les plateformes de livraison. « Ça se joue énormément sur l’image », reconnait Elliot* en rangeant son MacBook à la fin du service. Installé sur une chaise en plastique entre les poubelles et la porte d’entrée du local, le jeune homme a pris le temps de jeter un coup d’œil sur les statistiques de la journée. Récemment, il est devenu operation manager pour la même boîte que Jeanne. Son job ? Superviser et observer les performances des trois dark kitchens que compte l’entreprise. « Je viens du monde de la restauration et j’essaye d’inculquer certaines de ces valeurs à mes employeurs mais c’est compliqué. Ils viennent d’écoles de commerce et voient les choses différemment. »
Preuve que la stratégie de communication est au centre de ce nouveau business, les startups font souvent appel aux agences de marketing pour trouver les noms des marques. Ce sont elles qui les aideront également à trouver le bon logo et à créer le fameux « storytelling » qui attirera le chaland. Dans une récente interview pour le magazine Business Insider, Clément Benoît – le fondateur de Not So Dark – l’assurait : « Le job pour se faire connaître est rapide. Une bonne note des clients et de jolis visuels suffisent. »
Mais derrière la porte de la cuisine, les patrons de Jeanne et Elliot ont misé sur un minimalisme radical. Mis à part les éléments de base nécessaire à la confection des plats, le local parait encore bien vide. « Le premier jour, on n’avait même pas de cuillères pour remplir les pots de sauce. Pendant ma pause entre le service du midi et du soir, j’ai dû m’installer sur un sac de patates, comme il n’y avait pas de chaises », soupire Jeanne. Depuis, la jeune femme en a apporté une de chez elle, pour reposer ses jambes. « On attend encore l’eau chaude mais ça ne devrait pas tarder », ajoute Elliot, à moitié amusé.
Cette vision – principalement portée sur la rentabilité et l’efficacité du modèle – laisse peu de place à la fantaisie et l’authenticité. Ici, pré-préparation et sens du timing sont les maîtres-mots. « En moins de cinq minutes, la commande doit être prête et emballée », explique Jeanne, « c’est le nouveau travail à la chaîne ». Car au-dessus des cuisiniers, des operation managers, des livreurs et même des startupers règne un maître tout-puissant : l’algorithme, qui décide de mettre en avant ou de faire apparaître en premier tel restaurant plutôt qu’un autre. Et pour lui plaire, il faut surtout miser sur la rapidité, que l’on soit au début ou à la fin de la chaîne. Quelques secondes de retard sur la confection d’un burger et c’est toute la machine qui s’emballe. « En général, la cuisine arrive à suivre le rythme des commandes mais parfois elles s’accumulent. Et si elles ont du retard, ce sont les livreurs qui nous tombent dessus, parce que pour eux aussi, le temps presse » constate la dispatcheuse. Perdre ces précieuses minutes peut porter préjudice à tout le monde : d’un côté les coursiers, qui ne sont pas plus payés pendant leur temps d’attente (2.63 € la course en moyenne) et de l’autre le « restaurant », qui perdra en référencement sur les plateformes.
Des dark kitchens vertueuses, une utopie ?
Au nom de l’optimisation – sur le temps, le produit et le personnel – la règle dans la plupart des dark kitchens est de produire une cuisine simple à concevoir et à ingurgiter. Fast food, comfort food, street food ou malbouffe, chacun choisira la désignation qui convient à son combat, qu’il soit défenseur ou détracteur du concept. Pour le journaliste culinaire Emmanuel Rubin – auteur d’une tribune à charge contre les géants de la foodtech – les termes sont tout trouvés : « des nourritures faciles, molles, tristes burgers, faux sushis, pizzas veules de l’internationale alimentaire. » Sans juger de la qualité des plats, force est de constater – en déroulant le feed de l’application Uber Eats – que les menus de ces enseignes virtuelles se ressemblent souvent : tacos, poulet frit, bo-bun, ramen et sempiternels burgers. Une manière d’uniformiser involontairement mais profondément les goûts et les envies des consommateurs.
Du côté des cuisines gérées par Elliot, « tout est préparé à l’avance, en préférant des aliments qui peuvent être utilisés pour plusieurs recettes et plusieurs marques. » Dans quelques semaines, l’entreprise lancera une enseigne de salades et une autre de cuisine indienne, chapotées par l’operation manager. « Pour les salades, ce sera facile. Mais pour la nourriture indienne, c’est un peu plus chaud, il faut introduire de nouveaux produits dans notre liste d’achats. »
Galvanisées par la montée en puissance du phénomène, ces start-ups cherchent à gagner le plus de parts de marché. « Mes patrons comptent aussi ouvrir deux autres dark kitchens d’ici la fin de l’année », confie l’employé. Du côté des concurrents, 15 implantations au programme pour Smart Kitchen – créée par trois anciens de chez Sushi Shop –, un objectif de 100 cuisines en trois ans pour les Italiens du groupe Big Mamma et quatre nouveaux hangars pour Deliveroo. Quant à Uber Eats, avec une implantation dans plus de 33 pays pour sa plateforme de livraison, son chiffre d’affaires aurait augmenté de 224 % au 4e semestre de 2020 en passant à 1,4 milliard de dollars. En tout, ce sont déjà plus de 1000 restaurants virtuels disséminés sur le territoire français qui cherchent à séduire nos papilles.
Mais certaines structures indépendantes comptent garder une taille humaine et des valeurs proches de celles qui étaient les leurs avant le début de la pandémie. « Les plats que propose le Trois Quart ne sont pas du tout adaptés à la livraison. C’est une cuisine soignée et bien dressée qui serait arrivée endommagée, mal cuite ou à mauvaise température chez le client », reconnaît Nathan Levy. En lançant leurs nouvelles enseignes virtuelles – Sümmak et Kümin – les deux Marseillais comptent garder le lien avec la clientèle du Trois Quart et proposer aussi de la vente à emporter, plutôt que de miser uniquement sur Deliveroo ou Uber Eats. « On préférerait se passer de ces grosses plateformes pour lancer le projet mais c’est impossible. Si un jour on cartonne, on mettra en place notre propre système de livraison, parce que je préférerais ça plutôt que de donner presque 30% de commission à ces entreprises. »
En révolutionnant en profondeur notre rapport à la restauration, les plateformes de livraison et autres dark kitchens se sont rapidement rendues indispensables. « Sans elles, pas de visibilité », assure même Nathan. Mais ces outils numériques – initialement vantés comme un service à destination des restaurateurs – ne se seraient-ils pas insidieusement intercalés entre ces derniers et leurs clients, jusqu’à truster leur manière de communiquer ?
Quand certains chefs défendent encore une autre vision de la gastronomie – plus proche de l’artisanat que de la grande distribution – le business model de la dark kitchens séduit les désenchantés du covid, qui ont vu les rideaux de leurs restaurants se baisser et leurs terrasses se vider. « C’est très paradoxal comme sentiment », constate Nathan, « à la veille de l’ouverture, on est franchement fiers de ce qu’on a réussi à créer mais aussi un peu rebutés : on va vendre nos bons petits plats sur l’équivalent d’un Amazon de la restauration. »
* Les prénoms ont été changés.
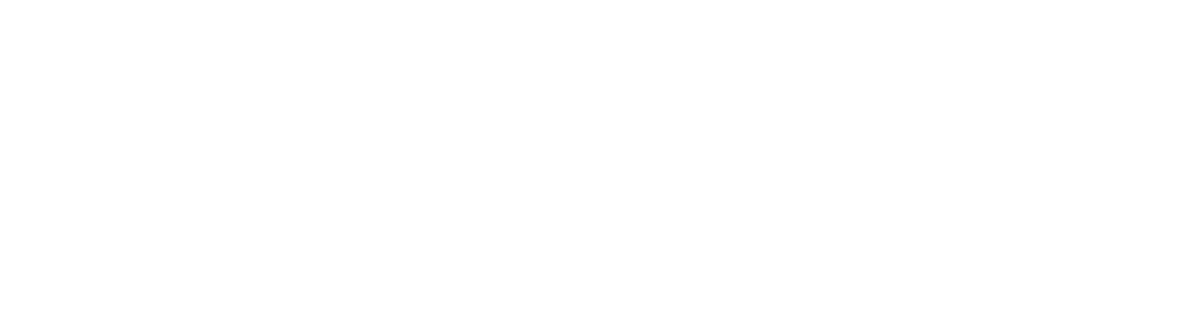
.jpg)
Identifiez-vous! (c’est gratuit)
Soyez le premier à commenter!