.jpg)
Jenny Bel’Air, icône historique du Palace
Une figure incertaine, mouvante et fluide. Mais surtout, inoubliable.
Ce texte est un extrait initialement publié dans le livre Le sens de la fête déjà disponible en librairie. Nous l’avons repris et adapté à URBANIA pour vous en proposer des bonnes feuilles. Bonne lecture !
***
Le sens de la fête , c’est un livre qui retrace une histoire orale de la fête à la française, de la fin des années 1970 à nos jours. Quinze témoignages intimes et sans tabous d’hommes et de femmes de toutes générations et de tous horizons, qui ont consacré leur vie à la fête : Laurent Garnier, Ariel Wizman, Bob Sinclar, Barbara Butch, Teki Latex… Parmi ces témoignages, on retrouve celui de Jenny Bel’Air, une créature romanesque, terrifiante et séduisante, qui marquera son époque.
Jenny Bel’Air est une icône, de celles qui ne s’oublient pas, une figure incertaine, mouvante et fluide. Tantôt lui, tantôt elle, Jenny explose les frontières du genre : le petit garçon métis né en 1957 se réinvente en diva élégante, excessive et radieuse. Dans les années 1970, elle monte sur scène presque par hasard et devient une figure des nuits gay parisiennes. Très vite, elle intègre l’équipe de physionomistes du palace où elle a le pouvoir de vie et de mort sur les prétendant.e.s à la fête. La déesse créole rend avec panache son jugement dernier aux fidèles du temple de la débauche. Le spectacle commence dans la rue, avant même d’atteindre le vestibule. Si le trottoir était sa scène, sa vie fut une galerie de portraits hors-normes.
Quelle place a eu la fête dans ta vie ?
Une place essentielle ! Cela permet de voir les choses différemment, dans le brouhaha de la musique, des gens et de la festivité, du verre cassé, des coupettes par terre et des bouchons de champagne qui sautent en l’air… Les bruits d’extase et de jouissance aussi ! La fête, c’est un moment d’oubli de la dureté de la journée. La nuit est un refuge.
On apprend dans ta biographie (Jenny Bel’Air. Une créature, François Jonquet, Éditions Pauvert, 2001) que ton enfance, « c’était du Dickens avec tout de même un côté chic ». Raconte-nous le milieu dans lequel tu as grandi…
Ce n’était pas évident. Mon père revenait du bagne : il avait commis un crime avant-guerre. Gracié, il a tenu le phare de l’île du Diable, en Guyane, et il a rencontré ma mère, une petite infirmière guyanaise. Ils sont venus à Paris sans argent, sans rien. C’était très difficile. Et v’là-t’y pas que pour calmer tout ça, ma naissance fut pour eux une joie ! Mais je n’ai pas eu d’enfance. On me l’a volée : maman est partie très tôt, à 42 ans, d’une manière douloureuse et effroyable, un cancer de la bouche. Après ça, il y a eu des hauts et des bas. Emmaüs pour les vêtements… Donc mon parcours est complètement à l’opposé d’un establishment bourgeois ou d’une famille classique.
Quels sont tes premiers souvenirs de fête ?
On habitait pas loin de l’avenue de la Grande Armée, à Paris. Naturellement, le 14-Juillet au matin, il y avait des militaires qui arrivaient avec des chars et tous leurs machins… C’était très impressionnant et fascinant ! J’allais tout de suite aux abords des Champs-Élysées. Je restais sur l’Étoile à attendre le président et la parade qui allaient arriver. Cette vision de guerre devenait une vision de fête. C’est très étrange. Cela aurait pu être flippant : des militaires avec des mitraillettes, comme on en voit aujourd’hui avec le plan vigipirate, qui cassent l’ambiance dans Paname. Mais là, ces soldats, ces gardes républicains, la musique, toute cette ambiance… Pour moi, c’était wow ! C’était génial quoi !
Qu’est-ce qui te plaisait là-dedans ?
Pas vraiment l’uniforme, j’avoue : ce qui me plaisait, c’était la musique et… les gros engins ! (rires) Je sais que tout le monde va rigoler… Calmez-vous, pas tout de suite… (rires) Les gros engins, je veux dire les chars, tous les trucs qui passaient et puis les avions : Bleu ! Blanc ! Rouge ! On est créoles mais on s’en fout, ce jour-là, il n’y avait aucune distinction de quoi que ce soit.
Petite, tu as été victime de racisme ?
Une précision tout de suite : « petit » et pas « petite », car j’étais un petit garçon. J’y tiens beaucoup parce que je n’étais pas une petite fille, je me suis inventé un personnage avec l’apparence féminine mais j’étais et je suis un garçon, sans contrefaçon ! (rires) Ça fait chier pas mal de gens qui m’identifient comme une diva, une femme. Tout ça, c’est un costume. J’affirme ne pas avoir une identité. J’admire ceux qui l’ont, cette identité féminine, les trans qui font un travail remarquable pour le respect de leur identité. Elles sont très cultivées, étonnantes et demandent une reconnaissance. Moi, je cultive l’ambivalence, le quiproquo, mais je ne vais pas jusqu’au bout de ce qu’elles font. Donc au départ, j’étais un petit garçon !
Alors comment ce petit garçon devient-il Jenny Bel’Air ?
Pas tout de suite… J’ai d’abord joué dans les caniveaux et ce n’était pas la fête. Après le départ de ma mère, mon papa est fatigué et il décède. Je me retrouve seul, vraiment seul, et extrêmement précaire. Je suis SDF pendant pas mal de temps, d’où cette histoire de Dickens et de Zola. Quand on est SDF, on doit survivre et on observe la fête que font les autres sans y participer. La fête de partir le matin, de rentrer le soir. De sortir d’une soirée ou d’y aller. Et, sans m’en rendre compte, je vais pourtant petit à petit rentrer dans cette fête…
L’un des premiers clubs où tu mets les pieds un peu par hasard, c’est Le Nuage3, une boîte de nuit à Saint-Germain-des-Prés…
Oui, une boîte de nuit derrière le drugstore Saint-Germain-des- Prés, vers la rue de Rennes, où il y avait des gigolos mâles qui faisaient le tapin et dont j’ignorais alors l’existence. J’y suis allé en début de soirée, parce qu’il fallait rentrer tôt pour ne pas perdre ma place sous le pont pour dormir. Ça fait un peu misérable ce que je raconte, mais peu importe. J’étais habillé de manière quelconque, mais toujours un peu propret. J’ai toqué à la porte et un mec m’a ouvert. Là, je vois des mecs et des nanas qui dansent dans la boîte. C’était assez joli ! (rires) Je me suis faufilé dans un coin, et j’ai assisté à un show, un spectacle avec des mecs qui se mettaient en femme et qui chantaient en playback Diana Ross. Ça m’a interloqué. Pas fasciné, mais interloqué. J’ai pu y retourner de temps en temps, c’est même devenu un repaire pour dormir. Et à moment donné, alors que je dors, on me réveille en pleine nuit : « Dis-donc » (sifflement) ! Comme je connaissais par cœur la chanson Oh happy day, v’là-t’y pas que l’autre me fout le micro sous le nez et me dit : « Chante, chante ». Alors j’ai chanté : « Oh happy day, oh happy day ! » (en chantant). Alors on me dit : « Wow, quelle voix ! Tu as une voix extraordinaire ! Allez, tu reviens demain ! » Vu ma gouaille, ils ont décidé de me garder, et m’ont demandé de présenter les spectacles. J’ai mis les deux pieds là-dedans au Nuage, où officiait déjà Guy Cuevas4 aux platines.
Donc tu as mis les pieds totalement par hasard dans ce monde qui va devenir le tien…
Je crois que le hasard est toujours un truc très étrange…
Décris-nous Le Nuage…
C’était tout petit ! Une petite boîte très sympa, créée par Gérald Nanty5. Il n’y avait pas de scène, c’était à plat. Une toute petite loge. À trois, on était déjà en train d’étouffer ! Il n’y avait pas vraiment de place pour les platines du DJ, c’était vraiment abrupt. Il était debout sur un tabouret, donc quand les gens dansaient, ils le bousculaient. Un jour, un DJ – je crois que ce n’était pas Guy – avait mis Nicole Croisille, Une femme avec toi. Une musique que j’aimais bien. À un moment, quelqu’un l’a poussé et subitement, le 33 tours est passé en 45 tours. Alors j’ai pris ce playback en accéléré et j’ai vu que ça faisait énormément rire. Je voyais des gens que je ne connaissais pas, des gens importants, de la mode, en train de pisser de rire dans leurs culottes. Quand la lumière tombe sur vous alors qu’on ne vient de rien, alors qu’on n’est rien… Quand on vous applaudit à tout rompre… C’est vraiment la meilleure des nourritures. Et wow, ça m’avait fait un drôle d’effet ! On m’a redemandé après. Alors j’ai fait Barbra Streisand, I’d Rather Be Blue, et en patin à roulettes, s’il vous plaît ! Je tombais sur mon fion ! Et tout Paris venait voir ça. Il y avait un truc.
Qui fréquentait Le Nuage à l’époque ?
Le cinéma français. Alice Sapritch, Thierry Le Luron, Jacques Chazot, Yves Saint Laurent, et d’autres du milieu gay de l’époque. Ils venaient dans ce petit truc pour s’encanailler. Mais je crois que les grands de ce monde venaient surtout pour boire au bar ou aux tables, pour se réunir. Ils avaient aussi leurs soucis, moi j’avais les miens. C’est l’humour et l’autodérision qui m’a permis de tenir et de m’en sortir. J’y tiens beaucoup. J’étais encore à chercher un endroit pour squatter, pour dormir, mais je voyais qu’avec l’humour et l’alcool aidant, ils se confiaient à moi… Et je me suis rendu compte que je n’étais pas seul dans le désarroi. Même si eux avaient un lit pour dormir, de l’argent, une célébrité… Ils ont tout mais ils se font chier. Qu’est-ce qui leur manque ? L’authenticité ou le bonheur. C’est là que j’ai compris, comme à l’école de la vie. On se dit : « D’accord, on n’est pas seul. »
À travers la nuit, tu as découvert la misère humaine, la misère affective ?
La misère affective, oui. Et puis cette misère de devoir se cacher. L’homosexualité était réprimée. Quelle boîte n’a pas connu subitement un contrôle à l’époque : le 18, le Scaramouche, Le Nuage, même Le Sept et j’en passe ! « Police, vos papiers, contrôle de police ! » On fichait les homosexuels. On était fichés !
Tu as réussi à oublier dans la fête les choses que tu voulais laisser derrière toi ?
Non. On se torche la gueule. On boit beaucoup : les coupettes, les godets offerts, les machins, les trucs… On est toujours enivré de quelque chose. Je parle uniquement de l’alcool pour moi, parce que le reste, je n’ai pas pratiqué du tout. Ayant vu dans la rue les désastres de la drogue, je n’en ai jamais pris. Une fois, on m’a foutu un acide, accidentellement. Ça m’a rendu malade pendant une semaine, parano et con, je me suis dit : « Ce n’est pas pour moi ». Coupette, coupette ! Ça a toujours été mon remède. L’alcool est une espèce de liquide maudit qui fait tout oublier. C’est une anesthésie du mal-être. Mais cette euphorie ne dure pas longtemps, parce que le lendemain matin, on n’est pas très en forme.
Un peu plus tard,tu découvres un autre haut-lieu festif du Paris interlope, un tout petit restaurant, Le Petit Robert…
Le Petit Robert, c’est un restaurant avec une connotation gay mais une approche très intellectuelle. Un milieu intellectuel de gauche que je ne connaissais pas à l’époque. J’y ai rencontré des gens fascinants : Bernard-Marie Koltès, Hervé Guibert… Vous voyez le genre qu’il y avait.
Tout ce petit monde, on le croisait aussi au Nuage ?
Non, c’étaient deux univers différents. Je l’ai bien ressenti quand j’ai rejoint le FHAR, le Front homosexuel d’action révolutionnaire, pour revendiquer le droit à l’homosexualité. On avait aussi un groupuscule de déjantées géniales, Les Gazolines : Maud Molyneux, Paquita Paquin, Hélène Hazera et plein d’autres gens… Mais certaines, très radicales, me trouvaient un peu traître. Parce que je traînais avec des tatas aux sacs Vuitton, à Saint-Germain-Des-Prés, prout- prout. Mais moi, que voulez-vous que je vous dise, c’était mon truc. Je n’étais pas si radicale que ça. Extravagante oui, mais radicale, pas vraiment.
Pour les militantes les plus radicales, la discothèque, la boîte de nuit, c’était l’ennemi ?
C’était bourgeois ! Elles étaient contre cette espèce de clinquant gay, un peu surfait. Il y avait un conflit constant.
Comment rencontres-tu Fabrice Emaer, le futur patron du Palace ?
Ce moment-là est inattendu. Il y avait beaucoup de bars rue Sainte- Anne : le Broad, le Pimm’s, le Piano club, le Colony, lui aussi tenu par l’extraordinaire Gérald Nanty qui aura ensuite le légendaire Mathis Bar. Gérald connaissait toutes les stars de la variété : Sylvie Vartan, Annabel Buffet… Et juste à côté de tous ces bars, il y avait Le Sept, un club ouvert par Fabrice Emaer et Claude Aurensan. Pas facile d’y rentrer à l’époque ! Jacquie était à la porte. Et ce qu’il y avait là-dedans… Je n’étais pas au courant. Mais on m’y emmène. Vous arrivez alors dans une petite entrée, vous longez un long bar et sur la gauche il y avait des vitres, avec un grand restaurant et des gens qui brillent de mille feux, des femmes endiamantées qui fument. Et puis vous descendez un escalier vers une énorme cave avec des néons de toutes les couleurs. Vous y retrouvez Guy Cuevas et d’autres. Il y avait la musique la plus incroyable de l’époque : Bobbi Humphrey, et pleins d’autres musiques envoûtantes, endiablées… Wow, ils sont festifs, ils sont heureux, ils sont bourrés, ils sont bien ! Claude Aurensan est là, rude, sévère, mais il fait exactement ce qu’il a à faire. Il joue sa partition complète pour les gens qui venaient pour la fête. Et un autre monsieur est là, très distingué, assez long, assez grand : Fabrice Emaer. Très à l’aise, il accueille les gens au restaurant avec un phrasé très ralenti. J’observe qu’on y parle différemment. On y a une attitude. Là, dans un coin, il y a Yves Saint Laurent, Valentino, David Bowie… C’est inouï ! Puis, petit à petit, j’y vais souvent, je danse, c’est la fête ! La fête, la fête, la fête ! Et on se dit : « Tiens, la nuit nous appartient, enfin la vie nous appartient dans ce petit truc-là. »
Cela ne t’intimide pas ce milieu branché de la mode ?
Ah quand on ne connaît pas, on se dit au premier abord : « Mais ils sont méprisants ! » Mais on m’explique que non, que c’est comme ça, c’est le milieu de la mode… Ils sont en représentation. Je découvre un monde totalement différent du mien, mais festif ! Un truc étonnant ! Pas facile, surtout quand on est habillé en graillon comme moi, imaginez-vous mes enfants… Les Vamps ! Vous voyez les Vamps6 ? Ben c’est moi en charentaises, maquillée avec une blouse, une jupe, un collier pris aux Puces… Un truc invraisemblable quoi. Avant Le Palace, Le Sept c’était déjà un petit Versailles.
C’était en quelque sorte les prémices du Palace ?
Oui. Dans le choix musical et dans la fréquentation du gotha.
Fabrice Emaer avait le génie de la fête. C’était quoi ce génie ?
L’intuition de savoir rassembler. De placer, de faire de l’humour, en Monsieur Loyal de la fête et des nuits. C’est une sorte de mix de la vie. Mixer la fête, c’est mixer la vie. Fabrice avait ce don-là. Éclairer comme une paillette constante des gens qui sont sans lumière. C’est beau. Je trouve ça très bien. Je le remercie d’ailleurs.
Et le génie d’un DJ comme Guy Cuevas ?
De doser : une chanson américaine avec une autre qui parle d’amour, qui parle d’espoir, une autre avec Diana Ross… Être bon DJ, c’est savoir avoir quel disque enchaîner pour raconter une histoire. C’est un message. Guy a toujours eu ce don.
En 1978, Fabrice Emaer reprend le Théâtre Palace. Il te confie tout de suite l’entrée ?
Non, pas du tout. Je suis invitée à l’inauguration en 1978, comme tout le monde. À la porte officie Edwige Belmore, la reine des punks, un personnage étonnant, d’une androgynéité sublime. Une fille d’une beauté à tomber par terre. C’est elle qui ouvre la porte avec Fabrice et qui va donner le top départ à 23 heures, avec un peu de retard d’ailleurs. C’est elle qui va rentrer dans la légende. Pas moi.
Quels sont tes souvenirs de cette inauguration ?
Que soudain nous étions dans un théâtre immense : nous ne sommes plus 400 ou 500 personnes, nous sommes 2 000, 2 500… et 1 000 dehors ! « Le théâtre est ouvert pour tout le monde », comme disait Fabrice. C’est un choc, en 1978. On avait vu ça dans les années 1920, les années 1930, mais là : c’est un événement. Et il va se passer une nuit légendaire, où nous découvrons une panthère que personne ne connaissait encore : Grace Jones, qui va faire un show mémorable. Mémorable ! Paris prend enfin sa revanche sur le Studio 54 de New York. Paris a sa grande discothèque. Des gens de tous milieux, de tous bords, vont s’y rencontrer et faire la fête pendant pas mal d’années.
Une autre nuit particulièrement mémorable ?
Une fête de Karl Lagerfeld intitulée « la Nuit des doges de Venise ». Éric Starck me dit : « Écoute, on va préparer quelque chose ». Je ne travaillais pas ce soir-là, mais il insiste : « J’ai construit un truc. » Il m’emmène alors dans un parking avenue Foch, où il habitait, et là : il avait construit une gondole ! Une gondole pour deux personnes, décorée façon Venise. « Voilà, on va rentrer au Palace avec ça. J’ai appelé six pompiers de Paris pour nous porter. » Et nous v’là-t’y pas arrivés au Palace pour l’ouverture de la soirée. Il y avait un monde de dingue, tout le monde déguisé dans tous les sens, des costumes chics… Moi je suis en espèce de marquise et lui en marquis, portée par les pompiers. On a mis un temps fou à rentrer avec notre gondole ! Et à un moment donné passe une nana habillée en Madame de Montespan, le décolleté un peu trop plongeant, les tétons à l’air… Les pompiers la regardent, ils loupent la marche et on se casse la gueule ! On est par terre ! C’est une fête sublime. Tout se finit très tard. Le monde entier en parle.
Comment tu expliques cet engouement autour du Palace ? Pourquoi, tout d’un coup, ce club est-il si différent ?
Parce que l’époque est un peu poussive. Il y a une giscardisation des esprits… Nous sommes nombreux à espérer l’arrivée de la gauche pour donner un élan de liberté. Et Le Palace tombe à point nommé. Le club va aussi offrir la possibilité aux gays de se réunir le dimanche lors des Tea Dance, un thé dansant pour se rencontrer, pour draguer… Une totale possibilité de liberté !
Peut-on parler de fête sans parler de politique ? Surtout à cette époque…
Tous les patrons et patronnes de boîte, aussi bien pour garçons que de boîtes lesbiennes, se plaignaient déjà des difficultés d’ouvrir une discothèque. Un club gay, ça dérangeait le voisinage. Nous étions à l’époque de la pièce de théâtre La cage aux folles… La caricature de l’homosexualité était à son comble, grotesque.
Des lieux comme Le Palace ont contribué à changer les mentalités…
Mais oui ! Parce que riche, pauvre, hétéro, bi, transsexuel, travesti du bois ou je ne sais quoi, tout le monde a pu passer cette porte.
C’était ton rôle en tant que physio, de créer ce melting pot. Il est difficile à créer et à tenir sur la durée ?
C’est terrible. Très compliqué. Entre ceux qui arrivent gentiment pour faire la fête, lookés, qui jouent le jeu, et les violents qui arrivent pour casser du PD, ou pour suivre une nana un peu pétée et qu’il faut faire barrage… Et puis, il y a les gens dits « ordinaires ». Mais ce terme m’est insupportable puisque j’appartiens aux gens ordinaires, je suis dans l’ordinaire de l’ordinaire. J’appartiens au peuple ! Même si on me dit diva. Diva du trottoir, du bitume, c’est moi !
Tu racontes dans ta biographie qu’à un moment donné, à force de faire la fête, tu es devenue complètement folle : « Les nuits blanches m’ont fait perdre mes quelques repères. » Tu t’es perdue dans la fête ?
On ne peut que se perdre quand on ne fait que boire, bouffer, rigoler, boire, bouffer, rigoler… On en oublie la réalité, on en oublie de vivre, on pète les plombs. On se retrouve à porter des lunettes noires toute la journée, au secours, on est ailleurs et on s’en fout.
Propos recueillis par Christophe Payet.
****
Pour commander Le sens de la fête chez un libraire indépendant, c’est par là.
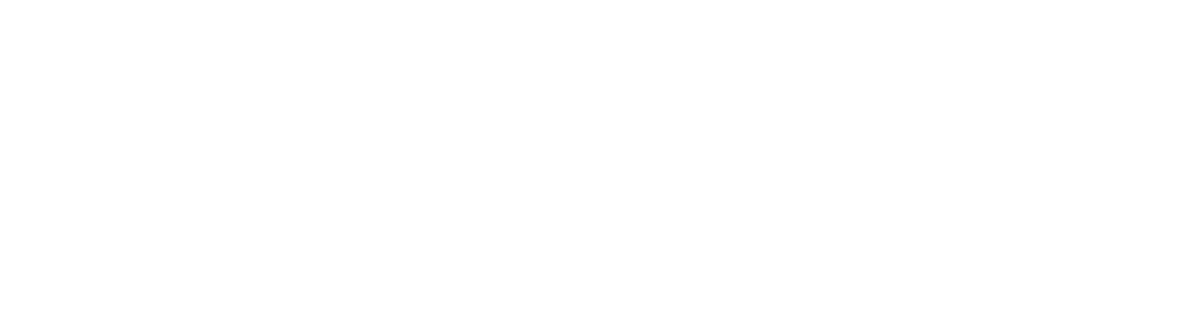
Identifiez-vous! (c’est gratuit)
Soyez le premier à commenter!