.jpg)
Dépression saisonnière, bonjour
Un phénomène cyclique qui pourrait être amplifié cette année en raison de la pandémie.
En cette rentrée 2020, sur le territoire français, il faisait beau. Il faisait bon. On a eu droit à une météo à la clémence inespérée. Surtout dans un contexte anxiogène, lié à la recrudescence du Covid-19. Comme s’il nous promettait des lendemains meilleurs, le soleil dardait ses rayons sur une France à nouveau confiante, l’été semblait vouloir jouer les prolongations.
Mais non. La saison estivale s’est officiellement fait la malle le mardi 22 septembre, journée du passage à l’automne. Transition brusque, accompagnée de trombes d’eau, d’une chute drastique du mercure, d’un épais voile de grisaille et de la ruine de mon humeur. En jargon médical, un changement psychologique impulsé par ce type de mue climatique, on appelle ça la « dépression saisonnière ».
Odyssée vers l’atonie
Cette année, comme chaque année depuis des années à l’heure de l’arrière-saison, je m’enfonce dans les méandres d’une mélancolie sans objet. C’est une tradition annuelle. Un peu comme un rendez-vous auquel on va à reculons, en compagnie d’une vieille connaissance. J’ai conscience que ça sera long et pénible. Je sais aussi que l’éclosion des bourgeons printaniers clôturera ce chapitre maussade, comme de coutume.
Concrètement, à la mesure où les journées se raccourcissent et perdent de leur luminosité, mon quotidien se larve. Les levers se font sans conviction, après une copieuse douzaine de « snooze ». Quitter l’ensemble pyjama relève de l’épreuve koh-lantesque. Alors que je mets un premier pied dans la douche, l’eau brûlante permet de me calfeutrer, quelques minutes encore, à l’abri d’une journée dont je n’attends déjà plus que le dénouement.
Ainsi, c’est en homme propre mais flirtant avec le désespoir que j’enfile ma paire de jeans, puis ouvre les volets. Au ciel faisant grise mine, je réponds par un rictus mal inspiré. Durant la journée, aussitôt attelé à une activité, je m’en épuise et n’aspire plus qu’à m’abîmer dans une sieste. Ou deux. Ou trois. Ou quatre ? Je m’exténue méthodiquement à force de songer au sommeil.
Puis arrive le coucher du soleil, instant où la « vacuité de l’être » – pour parler comme les philosophes – me frappe le plus vigoureusement. Passé cette étape de la journée, même les vannes de Chandler Bing (Friends) ne m’arrachent plus aucun sourire. Au moment de fermer l’oeil, je suis presqu’ivre de fatigue, mais je rate mon rendez-vous avec Morphée pour me coltiner une énième insomnie.
Les repas ponctuant ma journée, habituellement rehaussés par une savante débauche d’épices, virent progressivement à l’insipide. « Il faut manger pour vivre, et non vivre pour manger », déclamait dans un laconique aphorisme Socrate, qui n’était certes pas connu pour sa rock’n’roll attitude aux soirées. Bien vite, je fais mienne cette sobre maxime, et ne cuisine plus que des coquillettes au beurre pour me nourrir. Tantôt avec un appétit gargantuesque, tantôt avec le coup de fourchette d’un lilliputien. Toujours sans gourmandise.
Côté interactions, les réponses envoyées à mon cercle d’amis suivent le cheminement de ce que les précieuses du XVIIe appelaient élégamment un « retrait du monde ». À la question « Tu viens ce soir ? », il y a d’abord un réflexe d’obligation sociale qui s’incarne par le timide « Bien sûr ! Avec un peu de retard peut-être… ». Les semaines passant, je ne m’encombre plus de circonlocutions. Les « Je passerais sans doute une tête » de politesse chavirent fatidiquement vers la simple mention « Vu » sur Messenger.
Dépression saisonnière : histoire et caractéristiques
Comment expliquer cet engourdissement qui progresse tout au long de l’automne, et culmine en hiver ? Un coup de blues prolongé, engendré par la répétition des pluies et la persistance du froid ? C’est ce qu’on me répond habituellement lorsque j’évoque le problème. Mais je soupçonne un mal plus profond, un peu nimbé de mystères, dont ma grand-mère m’avait un jour parlé durant les années lycée : la « dépression saisonnière ».
Contrairement à ce que j’ai longtemps cru, cette expression ne renvoie pas à une croyance populaire. Le concept émerge en 1984, dans un article scientifique signé par le psychiatre Norman E. Rosental : Seasonal affective disorder. A description of the syndrome and preliminary findings with light therapy. Cette parution pionnière a posé les jalons de l’analyse des Troubles Affectifs Saisonniers (TAD), autre appellation de la dépression saisonnière. Quelques décennies après la publication de l’article, la notion s’est largement démocratisée. Mais sans être clairement définie, et au risque de devenir une formule passe-partout prêtant à confusion.
Lorsque j’interroge Alain Heril, psychanalyste et auteur du très circonstanciel Pour Surmonter la dépression saisonnière (2010), sur les causes du phénomène, il me cite la baisse de luminosité. Parfois aggravée par « l’association de moments difficiles », tels que le deuil ou la perte d’un emploi. Auquel cas « la grisaille extérieure est alors interprétée comme la représentation d’une grisaille intérieure » développe l’expert, avant d’illustrer à coup de Verlaine :
Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon coeur
D’une langueur
Monotone.
(Poèmes Saturniens, 1866)
Passé l’envolée lyrique, je l’interroge sur le nombre de personnes atteintes. « Les statistiques sont fluctuantes », prévient l’expert qui avance néanmoins le chiffre de 3 % pour la population européenne. Avec une sur-représentation des femmes, et des plus de 60 ans. Sans surprise, le thérapeute m’explique que, dans la mesure où la dépression saisonnière « intervient dès que la lumière du jour commence à décliner significativement », les zones géographiques à faibles expositions, éloignées de l’Equateur, sont les plus concernées. Si bien qu’en Alaska, le taux de malades avoisinerait les 9%.
Comment se soigner ? Comme la majorité des spécialistes, Alain Héril préconise la luminothérapie. Cette approche naturelle consiste à s’installer quotidiennement, pour quelques dizaines de minutes, près d’une lumière blanche de forte intensité diffusé par une lampe spécifique. De manière à compenser le manque d’exposition naturelle, puisque entre une journée d’été et une journée d’hiver, on passe environ de 130 000 à 20 000 lux – l’unité de mesure de l’éclairement lumineux.
Du point de vue biologique, la luminothérapie permet de convertir des rayons lumineux en signaux électriques qui agissent sur le cerveau. Et d’ainsi provoquer la sécrétion de sérotonine, un neurotransmetteur associé à l’état de bonheur. Outre le traitement par la lumière, le psychanalyste recommande une prise en charge homéopathique. Et conseille également des exercices de médiation, toujours utiles à la « relativisation des sensations de tristesse ».
La dépression, une affliction en mal de définition
Pour m’épargner la morosité des mois à venir, il me suffirait donc de commander sur Internet une lampe de luminothérapie. En déboursant une centaine d’euros, exit le spleen cyclique. Mais avant d’ouvrir mon portefeuille, reste à savoir si je souffre réellement de dépression saisonnière.
Afin d’en avoir le coeur net, je détaille mes maux à Pascal Henri-Keller, professeur de psychologie clinique à l’université de Poitiers et auteur de Lettre ouverte au déprimé (2008). Selon lui, mes symptômes (fatigue, trouble de l’appétit, isolement…) correspondent « très bien » à ceux de la dépression saisonnière. Mais alors que j’explique qu’ils sont apparus à l’adolescence, l’expert m’interroge : « Peut-être votre état a-t-il un lien avec une nostalgie ressentie pour cette période de votre vie ? ». Peut-être. Je n’avais jamais regardé dans cette direction.
Le thérapeute met en garde. « La notion de « dépression saisonnière » peut permettre d’éviter un travail auto réflexif, au profit d’un diagnostic facile à endosser qui ne nécessite aucune implication personnelle ». D’autres facteurs que la baisse de luminosité entrent parfois en ligne de compte dans la chute du moral, puisque les changements d’humeur liés à l’évolution des saisons « obéissent à des mouvements intérieurs très complexes ». Lesquels sont indissociables de données telles que « l’histoire familiale, la trajectoire de vie, ou encore les habitudes culturelles », pointe Pascal Henri-Keller.
Autrement dit, un diagnostic de dépression saisonnière peut entraver le processus de guérison. Dans le cas où il conduirait à faire l’économie d’une analyse explorant les « anciennes racines » d’une éventuelle souffrance dépressive profonde.
De fait, la dépression saisonnière n’est pas unanimement considérée par le corps médical comme une pathologie à part entière. Dans le DSM-5, ouvrage d’autorité du recensement des troubles mentaux, la notion apparaît sous le nom de « saisonnalité ». Et on la trouve imbriquée dans le sous-groupe du trouble bipolaire, ou de la dépression.
Or de manière générale, les avancées de la recherche concernant la dépression tâtonnent. Que celle-ci soit dite « saisonnière » ou non. Comme le rappelle Pascal Henri-Keller, en 2014 la revue Nature avait consacré un numéro complet sur le sujet. Conclusion ? « En un bon demi-siècle, aucune des recherches scientifiques menées dans ce domaine n’a permis de prouver l’origine biologique de l’état déprimé », retient le professeur.
Qu’elle soit étudiée sous l’angle neurologique, psychologique, social ou génétique, l’affection dépressive demeure difficile à circonscrire. En 2017 l’OMS évaluait à plus de 300 millions le nombre de personnes concernées par ce mal. Et on estime que près d’un Français sur cinq a déjà été touché, ou le sera durant sa vie.
Mais l’essentiel ne réside peut-être pas tant dans le diagnostic clinique, classificatoire, que dans l’écoute de soi. Que l’on se sente « dépressif », ou victime d’un down épisodique, l’impératif reste de ne pas sous-estimer ses symptômes. Plutôt que se laisser sombrer, surtout dans une « ère covid » qui agite tant d’épouvantails, il ne faut pas hésiter à consulter.
Que ce soit pour engager un dialogue de long-cours auprès d’un thérapeute, se faire prescrire des anti-dépresseurs ou se voir conseiller une luminothérapie. Dans la mesure où toute souffrance psychologique est singulière, les réponses qu’on y apporte peuvent l’être aussi. Si certains parviennent à lutter contre leur anxiété à grand renfort de lampes 10 000 lux ou d’infusions au tilleul, c’est tant mieux.
De mon côté, le fait d’avoir partagé mon ressenti avec des professionnels m’a déjà soulagé. Pour faire front face aux assauts météorologiques d’octobre-mars, je ressens néanmoins le besoin d’engager une cure à ma sauce. Au programme : replonger dans les écrits de l’auguste Freud, feuilleter négligemment Lucky Luke de mon enfance. Et surtout : cultiver mon addiction pour les vidéos relaxantes qui fleurissent sur Youtube. Article à venir sur le sujet…
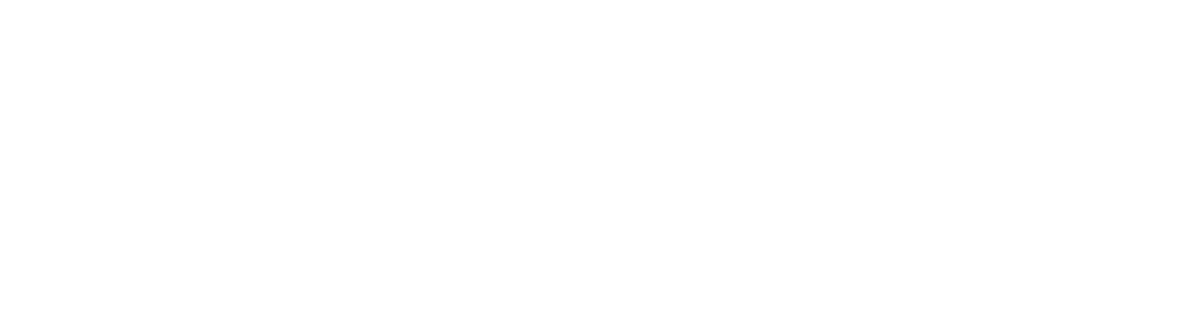
.jpg)
.jpg.webp)
Identifiez-vous! (c’est gratuit)
Soyez le premier à commenter!