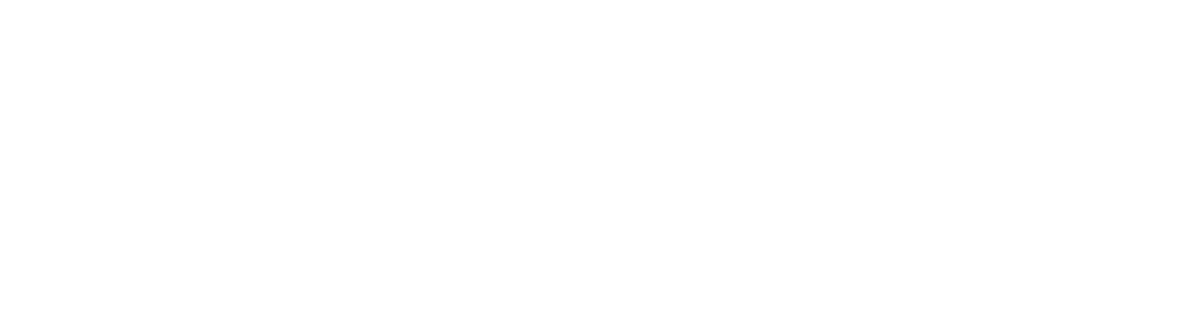.jpg.webp)
Afida Turner, un mystère en pleine lumière
On a tenté de percer le mystère de la diva la plus exubérante du PAF.
Auto-proclamée « fucking star » depuis ses débuts dans Loft Story 2 il y a 20 ans, diva-troll, chanteuse et show-girl, la reine exubérante du divertissement français s’est récemment essayée au théâtre avec Requiem pour une conne, pièce quasi-autobiographique où elle a écrasé la scène et ses collègues. Entre excentricités linguistiques, frasques à gogo et éclats médiatiques, Afida Turner cherche la lumière depuis 20 ans. Elle la trouve, elle la perd, la vole et la gère. Mais à quoi sert-elle ?
Elle est un mystère qui cherche à prendre toute la lumière, et 20 ans de présence dans l’industrie du divertissement n’ont pas apaisé sa soif. Mégalomane, self made woman et ovni frisé-déjanté dans un paf aux cheveux lisses et fatigués, elle représente à elle-seule tout un pan de l’histoire médiatique française. De l’essor de la télé-réalité avec le Loft — un de ces « trucs de ringards » dont elle ne veut plus parler — au monopole télévisuel d’Hanouna en passant par les réseaux sociaux, Afida Turner a réussi à surnager dans l’océan de la pop culture avec son personnage excentrique, loin de l’oubli des uns et du naufrage des autres.
Or, comme tout mystère, elle est truffée de paradoxes. Amuseuse publique, musicienne auto-produite, candidate d’une kyrielle de télé-réalités et performeuse connue des boîtes gay, elle s’est récemment battue contre la mort sur les planches parisiennes dans Requiem pour une conne, sous le masque (à peine visible) d’Ina Star, diva has been et malade. Mais derrière tous ces projets demeure un seul et unique nom – celui d’Afida. Qu’importe l’œuvre, on ne voit que l’artiste. Et si elle peut s’attirer les moqueries et la fascination d’un second degré mal placé, elle affiche pourtant un million et demi d’abonnés sur Instagram, jongle avec les injures et les mots doux et impose une énergie puissante et décalée où qu’elle aille.
Dans le bar désert d’un hôtel de luxe près des Champs-Élysées, à côté de chez elle, elle se confond en excuses après un retard d’une heure : elle a été retenue par des fans. Plongée dans l’obscurité et les lumières tamisées, elle tousse 30 fois en cinq minutes et demande 4 fois à baisser la climatisation, retourne sa coupe de champagne jugé trop « plat », joue avec le trépied de son téléphone, objet incontournable des influenceuses qu’elle confie avoir acheté au Japon, et oscille pendant 45 minutes entre bris de sérieux et éclats de grotesque. Pour demeurer un mystère, certes, mais lequel ?
Exister par le juron
Afida Turner, c’est d’abord l’exubérance d’un langage violent. Où qu’elle soit, elle enchaîne les invectives et mélange le français à l’anglais comme une papesse du management. Elle n’a pas de honte à se décrire comme une conne, synonyme de « bonne poire » théorisé en bonne et due forme : « Une conne, c’est une fille comme moi qui ne sait jamais dire non et dont tout le monde presse le citron », dit-elle avant d’exploser de rire. À l’entendre, c’est bien : c’est même une preuve de bonté.
Pourtant, son ethos numérique est bien celui d’une usine à jurons. Depuis plusieurs années, elle a imposé deux marques de fabrique linguistiques, clocharda et jalousa, qu’elle dégaine à quiconque ose la critiquer : « Une clocharda, c’est comme une connasse. Elle envoie des bad vibes [mauvaises ondes]. C’est celle qui ne veut pas vous prêter son parfum ou ramasser votre téléphone quand il tombe. Mais ce n’est pas pour les sans-domiciles, pour qui j’ai beaucoup de tendresse et d’affection. » La jalousa, c’est pareil – l’antithèse d’une femme qui se dit « très positive » et dont la hantise est de « décevoir les gens ».
On compile pourtant ses clashs dans les médias, on recense ses perles sur Instagram, on la connaît pour l’étalage d’une pragmatique du discours où l’outrage paraît hors de contrôle : dans Requiem pour une conne, où elle campe le personnage fantasque d’une chanteuse toxicomane, séropositive et sur le déclin, elle fait tourner le juron à plein régime en rompant sans cesse le quatrième mur par un mélange d’opprobre et d’invectives – même au public. Cette explosion rhétorique n’est pourtant pas agressive, selon elle. À l’écrit, elle préfère les majuscules car elle trouve ça « beau et plus lisible ». La haine, elle ne la connaît pas, « on aime seulement [la] détester ».
Autre corde à son arc : la gouaille sexuelle et les blagues graveleuses qu’elle déploie avec maestria. Comme elle l’affirme, « je ne suis pas chroniqueuse, mais une grosse niqueuse. » Ce langage exubérant et travaillé, partie intégrante de son personnage depuis le Loft, est le corollaire de son style extravagant de « poupée ». Toujours en robe moulante, cuissardes ou hauts talons, la bimbo est un bulldozer rhétorique, une machine sur-caféinée qui rase tout sur son passage. Dans son ego-trip, elle est une œuvre d’art post-moderne, « un prototype, une invention, une création d’amour ». Quand elle lance de but en blanc : « Venez, on fait une story ! », c’est la honte suprême — elle prend toute la place et nous relègue dans le contre-jour. Mais elle s’en fiche, elle s’impose et elle domine.
Désir insatiable de lumière
Ce besoin de lumière, on le lie aisément à son enfance dans le Nord, une somme de souffrances qui marque le point de départ d’un storytelling bien rodé. Auto-proclamée « fille du peuple », orpheline témoin du meurtre de sa mère par son père à l’âge de 2 ans et balayée dans les familles d’accueil, elle a nourri une rage de vaincre dès l’adolescence : « Quand vous n’avez pas de papa ni de maman, vous avez un esprit de survivant, ne serait-ce que pour manger, se loger et s’insérer dans la vie. » Et qu’est-ce que ça demande ? « Des grosses couilles et une grosse bite », assène-t-elle. Sensation de la deuxième saison de Loft Story, elle s’enorgueillit d’avoir été une Lil’ Kim française, « la première métis à danser en string sur M6 ». Elle analyse ce parcours médiatique avec lucidité, elle qui a « joué le jeu des médias » par pragmatisme « parce qu’il fallait manger », mais aussi pour satisfaire sa soif de visibilité.
Comme elle le dit, ce combat relève de la thaumaturgie : « Je suis un miracle, putain ». Baissant d’un ton, elle devient sépulcrale quand elle raconte son rapport à Dieu, une « énergie dans l’univers » entre un panthéisme à la Spinoza et les putti potelés d’une peinture renaissante. « Il m’a donné une énergie incroyable, un cœur unique, une rage de vaincre. Il a transformé mes défauts en atouts et m’a donné une crinière de lionne qui va avec mon énergie. J’ai commencé ma vie avec beaucoup d’obstacles, grâce à sa bénédiction j’ai réussi à les dépasser un à un. » À l’entendre, c’est lui qui a vengé l’enfant au « physique ingrat » qu’elle a été : « J’étais chrétienne quand j’étais petite. À la DDASS, une famille d’accueil où j’étais m’emmenait à l’église le dimanche avec ma grand-mère. Je voulais être enfant de chœur, donc je faisais partie de la chorale. Je passais mes journées à laver les tombes dans les cimetières, à suivre le prêtre. J’adorais ça. Ils m’ont bénie et m’ont donné la baraka ! » S’émanciper de cette mort omniprésente, des galères et de la pauvreté pour conquérir le monde. Rastignac moderne, elle a tout lâché pour conquérir Paris et exhorte aujourd’hui les faibles à se battre — avant d’ajouter : « Je pourrais avoir un glaçon ? »
Dans son trajet vers la gloire, Afida a fait sienne la mythologie du rêve américain et de l’ascension ex nihilo. Ex-compagne du regretté Coolio et du fils de Tina Turner, elle s’est imposée comme une self made woman obsédée par la réussite. D’ailleurs, Dominique Strauss-Kahn, « beau mec qui sait d’où il vient » et Bernard Tapie, ses présidents idéaux, figurent au rang de ses principales références. Ses modèles, Madonna ou son ancienne belle-mère, ont selon elle « énormément joué à la conne », c’est-à-dire travaillé pour s’imposer. « Quand vous avez choisi un métier gouverné par les hommes, que ce soit l’entertainment ou la musique, il faut se battre. […] Je suis autoritaire. Il faut que ça grouille, je donne des ordres toute la journée. Je suis obligée car il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je dois faire la Polizei. ICH BIN EIN POLIZEI ! »
Pour autant, Afida n’a rien d’une féministe. Ce genre de préoccupation, elle s’en fiche. Quand elle évoque ses souffrances passées, son regret « d’avoir fait confiance à des enculés », en amitié comme en amour, elle n’embrasse aucune cause. « Je ne me pose pas ce genre de questions… Il faut juste arrêter de se faire avoir. » Et pour cause, l’icône gay joue avec l’identité : « Je dis toujours que je suis un homme dans un corps de femme. Je me sens homme mais aussi très féminine : j’ai le physique d’une créature. […] Je suis femelle et masculine, sauvage et tigresse. D’ailleurs, je suis fan des lions, des bébés lions, des chevaux et de la nature. » Un lyrisme de la simplicité qui tranche avec l’image de son personnage.
Paradoxes d’un divertissement
Derrière l’outrance des images se cache une âme étrangement humaine. C’est le paradoxe d’Afida Turner : le cumul des ambivalences. Elle dézingue les néo-influenceurs « mythos » mais a construit une image à la fois dénuée et sursaturée de filtres, glisse des caprices de « vraie star » à la gentillesse, du grotesque au sérieux ou de la menace à l’amour, ce « plaisir incommensurable » dont elle se nourrit grâce à ses fans. « Quand vous faites un show et qu’il n’y a que de l’amour chez les gens, c’est fou. C’est comme quand je me réveille le matin avec mon petit bichon et que je vois son petit nez rose sur mon épaule, quand j’embrasse mon cheval Colombe, quand je vois les oiseaux et la nature. C’est de la tendresse. » Un amour qu’elle prend au premier degré et en toute sincérité, « mieux que le pognon et le champagne » qu’elle ne quitte pourtant jamais.
Combattre pour les humbles pourrait d’ailleurs être sa mission – car, en matière politique, la diva est surprenante. Elle qui semble vivre pour le succès et le luxe défend les gilets jaunes, comprend les pauvres et s’insurge contre la misère persistante : « Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de clochards quand on a autant d’appartements vacants à Paris. Je ne comprends pas que les gens puissent gagner 800 ou 900 balles par mois. J’étais comme eux avant, les gens qui se lèvent et bossent j’en vois encore tous les jours. »
Elle voudrait rehausser les salaires, défendre la réinsertion sociale des sans-abris, mais aussi donner l’opportunité aux femmes de s’épiler et se faire les racines… tout ça en croyant dur comme fer en son destin présidentiel. Après avoir franchi un cap dans le troll en lançant sa candidature aux présidentielles sous le hashtag #Afida2022, elle parle de cette annonce comme d’une télé-réalité : « Ça a été une réelle tristesse de ne pas pouvoir continuer l’aventure… Mais il manquait le budget et les parrainages. » Quand on sourcille, elle poursuit : « Je pense que j’aurais pu être élue à la place de Macron. Si j’avais été là, il n’aurait pas pu gagner. » La star a perdu, elle l’avoue, mais elle croit encore à ce rêve dont on ignore, comme ses autres déclarations, s’il est véritablement sérieux.
Afida Turner, c’est peut-être une poésie romantique — des éclats de sérieux rompus par l’excentricité du grotesque. Derrière toute l’exubérance des jurons et de la férocité se cachent des blessures et une lucidité sur le monde du divertissement qui motivent, coûte que coûte, une quête effrénée de lumière. Comme elle le dit : « You have to play the game, darling ». Jouer le jeu, donc, celui du business où la production est la seule chose qui importe. Afida, c’est la puissance du divertissement conçu comme un buzz constant, une lumière sensationnelle où les contours de l’ironie sont toujours plus flous au fil des jours. Comme tout mystère, elle est une constante ambivalence, un florilège de contradictions, un être-de-tensions qui aboutit (diront certains) au non-sens. Accro à Instagram, elle finira cette rencontre en demandant d’éditer sa story : « Vous êtes doué pour ça… pas comme moi. »
Identifiez-vous! (c’est gratuit)
Soyez le premier à commenter!