.jpg)
Après de longs mois de reports, HBO Max vient officiellement d’annoncer son arrivée dans l’Hexagone, courant 2024. De quoi foutre les chocottes à toutes les plateformes de streaming déjà bien installées sur le marché français. Car avec un catalogue qui contient certaines des séries les plus primées de tous les temps (Euphoria, Chernobyl, Six Feet Under, The Wire, Succession, Years and Years, Sex and The City, Game of Thrones, True Detective, The Leftovers, The White Lotus…), la chaîne de télévision américaine a su s’imposer en moins de trois décennies comme la référence de la fiction de qualité. Mais s’il fallait ne garder qu’un seul feuilleton parmi tous ces succès, ça serait peut-être Les Soprano.
Régulièrement portée au pinacle par les critiques et le public, l’œuvre de David Chase (le créateur de la série) justifie à elle seule l’invention du format sériel. Déclinaison rugueuse du soap opéra bêtifiant et des séries chorales proprettes, presque 20 ans après son dernier épisode, cette saga familiale n’a pas pris une ride et a changé pour toujours le paysage audiovisuel.
POUR SON CASTING EXTRAORDINAIRE
Mine patibulaire, carrure de déménageur et larges pognes capables de vous broyer les abattis en quelques secondes : James Gandolfini semble taillé pour le rôle de parrain local, l’iconique Anthony Soprano. Pourtant, c’est dans l’ambivalence du personnage, dans cette sensibilité qui affleure soudainement entre deux bastons et trois homicides, que l’acteur révèle l’étendue de son immense talent. Au détour d’un sourire espiègle qui désamorce une situation de tension, ou à travers son regard désarmant de gamin submergé par sa propre violence : le comédien se déplace toujours avec souplesse sur le fil tendu de l’émotion.
Et il n’est pas le seul à briller à l’écran ! Edie Falco, magistrale en femme au foyer désespérée par son mafioso de mari, constamment tiraillée entre sa culpabilité judéo-chrétienne et ses propres envies, ou encore Tony Sirico – seul vrai voyou de la série (le comédien a appartenu au milieu mafieux dans les années 70) – génial en petite frappe imbécile, sans cesse rattrapée par son impulsivitié : tout le casting est au diapason.
PARCE QUE LA SÉRIE A UNE VRAIE PORTÉE FEMINISTE
Des plans sur des danseuses topless qui se balancent sous les néons d’un strip-club, des femmes constamment objectivées par les protagonistes, parfois passées à tabac (grosse pensée à Adriana), des personnages faire-valoir de porte-flingues, et dont la survie dépend souvent d’une bague au doigt ou de la naissance d’un mioche. Des fantômes de ménagères qui s’effacent au profit de grosses brutes misogynes, et meurent à petits feux dans des prisons dorées où elles noient leurs espoirs d’émancipation au fond des piscines et des verres de mauvais Chardonnay…
A priori, la série n’a rien de féministe. Et pourtant, elle sonne encore aujourd’hui comme une critique virulente de la masculinité. Une identité si fragile, si ébranlable, qu’elle écrase les autres pour se rassurer et maintenir coûte que coûte son éphémère emprise – puisque les hommes, aussi puissants soient-ils, restent finalement minuscules face à la mort et la vieillesse qui les rend grabataires. Une soif de domination absurde, vaine et mortifère, dont les femmes sont les premières victimes, et trop souvent les dommages collatéraux. Après tout, la hiérarchie mafieuse, dans son organisation autoritaire, ses rapports de subordination et son exaltation de la puissance virile, est l’une des formes les plus abouties du patriarcat. Et la série ne se prive jamais de montrer le piège et le malheur qu’il renferme.
PARCE QUE C’EST UNE GRANDE FRESQUE AMÉRICAINE
Cette Amérique des périphéries, qui sent la loose, les zones industrielles et les rêves crevés. Ces fantasmes de grandeur et d’ascension sociale qu’on a laissé mourir sur un coin de trottoir ou à la porte de New-York, la métropole voisine si proche et pourtant hermétique aux espoirs de réussite des enfants d’ouvriers. C’est l’Amérique des classes moyennes et des petits trafics, des mensonges que l’on se raconte pour lier son existence à un héritage plus grand, pour se fabriquer une destinée dans la mémoire de ses ancêtres qui ont traversé l’océan.
C’est l’Amérique des addictions aux opiacées et de la pauvreté rampante, des promoteurs immobiliers qui finissent d’enterrer l’insouciance des quelques rescapés du cynisme sous des tonnes de ciment… C’est l’Amérique prédatrice, segmentée et raciste des descendants de migrants, ceux qui gravissent les échelons en se servant des plus précaires comme marchepieds. Le dernier arrivé ferme la porte, paraît-il. Et dans la micro-société mafieuse du New-Jersey, le premier qui atteint le sommet balance les autres dans l’Hudson lestés d’un bloc de béton.
POUR SA RÉALISATION NON FORMATÉE
A l’heure des formats pré-mâchés, des mises en scène uniformisées et passées à la moulinette des exigences des plateformes, des esthétiques bien calibrées, des scénarios standardisés pour aller vite et faire avancer le récit à chaque scène, des montages expéditifs qui ne donnent jamais au spectateur le temps de d’apprécier la vérité des silences : la réalisation des Soprano fait du bien. Avec ses références aux westerns, aux films noirs et à l’étrangeté onirique d’un David Lynch (dont David Chase est un grand fan), l’identité visuelle de la série est aussi ciselée que son écriture.
POUR CE TABLEAU AU VITRIOL DE LA MAFIA
David Chase (le créateur de la série) a grandi dans le New-Jersey. Gamin, il était fasciné par ces figures de mafiosi qui hantaient les rues de sa petite ville. En grandissant, il a décidé d’arrêter de fantasmer ces gangsters, et de les montrer pour ce qu’ils sont. Loin des images d’Epinal qui ornent les murs des chambres d’ados, loin de ces têtes brûlées, de ces leaders charismatiques, classes et loyaux, dont le code d’honneur justifie toutes les saloperies.
Il nous donne à voir la pègre pour ce qu’elle est : un panier de crabes pourri, où les égos boursouflés et les intérêts personnels surnagent au-dessus des belles valeurs et des serments que l’on se fait. Où les promesses de sang, les alliances et la fraternité ne résistent jamais très longtemps face à l’appel du fric. Où la trahison se négocie. Où l’amitié est factice, et toujours conditionnée. Où les travailleurs, les ouvriers, les gens intègres, payent cher le prix de leur insubordination ou de leur honnêteté. Une laideur morale, une médiocrité, qui se retrouvent d’ailleurs sur les visages.
Traits grossiers, expressions figées – parfois à la limite de la caricature pour Paulie et Silvio – derrière leurs traditions, les membres du clan sont des gargouilles séculaires qui protègent un seul dieu : celui de l’argent.
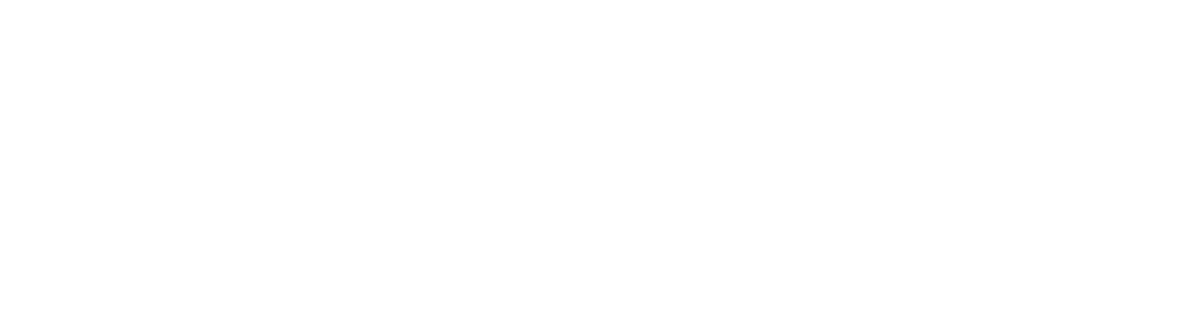
.png)
Identifiez-vous! (c’est gratuit)
Soyez le premier à commenter!