.jpg)
30 ans plus tard, Shepard Fairey n’entend toujours pas obéir aux règles du graffiti
Entrevue avec l’homme derrière les légendaires affiches OBEY.
De tous les logos dans le monde du streetwear, OBEY a assurément l’un des plus reconnaissables. Le visage du lutteur français André Roussimoff, alias André the Giant, qui fut décliné à travers des centaines d’œuvres par l’artiste américain Shepard Fairey, est maintenant affiché partout dans le monde, sur des murs, des autocollants, des t-shirts, des skateboards…
Lorsqu’il explose en popularité au début des années 2000, Shepard Fairey aide sans nécessairement le savoir à faire entrer le monde du graffiti dans le mainstream, et devient une figure importante de ce qu’on appelle maintenant le street art.
Fairey était à Montréal, à l’occasion du Festival Mural, pour lequel il a avec son équipe réalisé une grande murale sur le boulevard Saint-Laurent, à l’angle Prince-Arthur. On y était aussi ! On en a donc profité pour parler avec la légende du monde de l’art de rue, et faire le point sur sa carrière, l’état actuel de la scène du graffiti et des talents que de peindre dans l’illégalité lui a conférés.
Avant de développer le style pour lequel on te connait, qui se compose de pochoirs et de wheatpastes, faisais-tu du tagging ?
Je n’ai jamais été un graffiteur au sens traditionnel du terme. J’ai toujours préféré les collants et les affiches comme forme de tagging. Mais j’ai quand même été arrêté 18 fois pour vandalisme ! J’en ai fait, des conneries…
Est-ce que le fait que ton médium soit différent a eu une influence sur ton street cred dans la communauté d’art de rue locale ?
En fait, quand j’ai commencé en 1989, « l’art de rue » (street art) n’était pas encore un terme. Il n’est arrivé qu’au tournant des années 2000, surtout pour faire référence à ce que Faile, Space Invader, moi-même et une poignée d’autres artistes faisions, ce qui ne pouvait pas vraiment être classé comme du “graffiti” pur et dur.
De mon côté, je voulais simplement démocratiser l’art. J’aime le c�ôté malfaiteur de la chose, je veux mettre des trucs dans la rue, et je ne voulais pas que ce soit que mon nom. Le tagging c’est très cool, et je respecte énormément le talent créatif qui va là-dedans, mais ce n’est pas ce que je souhaitais faire.
Il y a des gens dans le monde du graffiti qui n’aiment que le graffiti. C’est leur choix, mais je trouve ça un peu fermé d’esprit. Puisque l’art est subjectif, je ne peux pas dire à quelqu’un ce qu’iel devrait aimer ou pas. Toutefois, je peux dire que le graffiti, une forme d’art rebelle dont le but était de briser des lois et enfreindre les codes, s’est certainement imposé beaucoup de règles et de codes, au fil des années… Alors quelqu’un qui se conforme aux règles et aux styles d’il y a 40 ans devrait, au moins, questionner l’ironie de se dire que ça c’est la forme la plus badass d’amasser de la crédibilité dans le street.
.jpg)
Qu’est ce que le fait d’avoir fait ça longtemps de manière illégale t’as appris comme leçon, pour la suite de ta carrière ?
Je crois que pour quelqu’un qui veut avoir un impact mais qui n’a pas de connexions ou de pouvoir, il faut être un briseur de codes et un preneur de risques, c’est essentiel.
Personnellement, je ne voulais pas être le spectateur de ma propre vie. Je voulais exposer ma personnalité au monde d’une manière qui aurait un impact, mais c’est un processus graduel. Il faut se bâtir un public, résonner auprès des gens, dégoter des opportunités.
Je pensais passer le reste de ma vie à être un ouvrier. J’avais ouvert une imprimerie de sérigraphie lorsque j’étais à l’université, et je pensais que je passerais ma vie à imprimer des contrats pour d’autres gens, et faire du street art la nuit, comme hobby, sans en retirer d’argent. Bien entendu, j’avais l’espoir que je réussirais un jour à me sortir de mon atelier et vivre de ce qui me passionnait réellement. Mais l’argent, pour moi, a toujours été secondaire. Faire ce qui me plaisait, c’était le plus important.
Comment s’est déroulé le dialogue intérieur, entre ton côté activiste et ton côté entrepreneurial ?
J’ai appris comment gérer plusieurs projets qui ont du succès en même temps par nécessité de survie. Au début, c’était : « Okay, je vais faire des prints dans mon atelier, certains que je vais afficher et d’autres que je vais vendre. » Après, Internet est arrivé et je me suis dit qu’il me fallait un site, parce que de vendre dans des boutiques ou dans des galeries, ça ne fonctionnait pas trop. Il fallait que je trouve un moyen durable de vivre de ma vie d’artiste.
Donc j’ai fait des chandails, que je vendais à mes amis skateurs. Et quand j’ai eu l’opportunité de faire quelque chose de plus professionnel avec ma marque de vêtements, c’était vraiment cool. Et tout est arrivé très vite ! Je travaillais comme imprimeur, puis comme designer graphique. Et d’apprendre à bien gérer toutes ces entreprises pour pouvoir canaliser mes ressources dans ce que je fais en tant qu’artiste a été l’évolution la plus positive qui soit.
Quand j’ai commencé à fréquenter ma femme, en 1999, elle était partante pour couchsurf avec moi et dormir dans des motels miteux, survivre par tous les moyens nécessaires en essayant de vendre des œuvres et faire des pop up. Elle s’occupait des livraisons par courrier, gérait notre compagnie de design, faisait la liaison avec les clients.
Puis, peu à peu, lorsque mes œuvres ont commencé à gagner en notoriété, j’ai pu prendre moins de contrats corpos, et me mettre à travailler plus fort sur mes prints, mes designs et ma marque de vêtements.
.jpg)
As-tu trouvé ton équilibre, en termes de travail « administratif » vs. « créatif » ?
Je ne gère pas trop les compagnies. J’ai une solide équipe, donc je passe la plupart de mon temps à faire du travail de charité, des murales, donc c’est cool.
L’équilibre est dur à trouver parce que je ne peux pas faire tous les projets que j’aimerais. Je veux faire tellement de choses à la fois, mais je veux aussi prendre le temps d’être certain que chaque chose est bien faite. Donc la balance quantité vs qualité peut être difficile à atteindre.
Mais j’arrive à faire beaucoup de choses dans une journée, je suis un workaholic. Je travaille beaucoup, mais j’adore ça. À part le stress des deadlines.
Puisque ton travail est, à l’essence-même, fait pour être exposé dans la rue,comment construis-tu tes expositions en galerie, comme celle-ci ?
Dans la rue, mon art emprunte de sa personnalité et de son charme à la rue elle-même, avec tout son chaos. Alors j’essaie d’utiliser ça et de le transposer, dans la texture et la frénésie, que ce soit tous les arrière-plans en collage, qui rappellent ce que je faisais dans le temps avec mes posters, quand les gens les arrachaient et qu’on pouvait voir ce qui se cachait dessous. Ou encore lorsque j’incorpore les pochoirs eux-mêmes, pour que tu puisses voir l’outil dans l’œuvre.
J’ai l’impression qu’il y a une relation naturelle entre ce que je fais en galerie et dans la rue, je ne considère pas l’un comme étant « meilleur » que l’autre. Mais j’aime que l’art de rue soit démocratique.
Tu sais, il y a des gens qui ont peur des galeries. L’avantage d’une galerie, c’est que c’est un environnement contrôlé. Je peux tout placer comme je veux et les gens viendront, regarderont les œuvres et seront prédisposés à vouloir le faire. Dans la rue, ils tombent dessus et c’est une découverte, qu’ils aiment ça ou non, ils y sont exposés. Je rentre dans *leur* monde, et non le contraire.
Une grande partie de ton œuvre est basée sur une certaine reproductibilité. Est-ce que cela a déjà joué contre toi ?
Beaucoup de gens ont essayé de copier mon style, certains réussissent à s’en rapprocher. Mais je crois que mes œuvres sont vraiment reconnaissables. Une grande partie de mon art consiste à montrer aux gens ce qu’on peut faire avec des outils simples. Donc si des jeunes voient ça et que ça leur donne des idées, je suis tout pour !
Par contre, je veux aussi qu’ils évoluent, qu’ils développent leur propre style. Je me suis grandement inspiré de vieilles affiches constructivistes soviétiques et du travail de Barbara Kruger, mais je crois que j’ai aujourd’hui mon propre style qui ne peut pas simplement être vu comme une copie de ce que font d’autres gens.
Depuis tes débuts, il y a toujours eu un aspect dystopien à ton œuvre ; un sentiment d’avertissement par rapport à de grands bouleversements à venir. 30 ans plus tard, comment te sens-tu de voir ces bouleversements se concrétiser ?
Je dois dire que je préfère me concentrer sur tous les avancements qu’on a pu voir, mais on a grandement régressé, dans les dernières années. Trump a été un désastre complet pour les États-Unis : le poison est maintenant dans le sang de la nation. C’est déprimant, mais je sens aussi qu’il y a toujours un contrecoup à toutes les avancées qu’on tente de faire.
Obama a pu devenir président, et bien que je ne sois pas d’accord avec toutes ses actions en tant que président, je crois que ça a été une importante avancée dans la bonne direction, idem pour la nomination de Kamala Harris.
Mais il y a pas mal d’enculés remplis de haine, qui essaient de tout faire dérouter. Je le vois comme un retour du balancier, et tout ce processus est frustrant. Mais j’ai besoin d’adopter l’approche selon laquelle le progrès n’est pas toujours instantané et qu’il y a toujours des embûches. J’ai une vision à long terme, donc je ne peux pas me laisser devenir abattu ou cynique.
.jpg)
Est-ce que c’était évident pour toi que ton travail aurait un jour cette portée ?
Pas du tout, c’était l’aspect de vandalisme qui m’intéressait ! Tu sais, c’est drôle, parce que ce que je fais a longtemps été vu comme étant de la dégradation de biens, comme un truc moche qu’il fallait éviter. Et aujourd’hui, on me traite de gentrifieur, parce que pour eux l’art est le signe qu’un quartier s’embourgeoise !
Mais ce sont deux situations : les artistes ne sont pas ceux qui font monter le prix des loyers. Les gens qui voient comment les artistes embellissent et ravivent un coin, et qui font bâtir de nouveaux développements ou reprennent de vieux immeubles à bas prix dans ces quartiers, c’est contre eux qu’il faut se fâcher ! Les artistes ne sont que le canari dans la mine.
Je dis toujours aux gens : ne blâmez pas celles et ceux qui tentent de rendre l’accès à l’art plus démocratique. Blâmez les gens qui exploitent l’opportunité de faire grimper les loyers, qui évincent les gens de leurs maisons ; il faut pousser les politicien.ne.s à punir ces enculés. Tu crois que la solution à l’embourgeoisement est de ne pas laisser les artistes faire des murales dans un quartier ? Ça deviendra simplement un graffiti illégal ! (rires)
Surtout à une époque où le graffiti est utilisé par plusieurs organismes communautaires comme une première pierre vers d’autres pratiques artistiques…
Je suis toujours content quand les gens peuvent trouver un moyen de vivre une vie créative au-delà de la malfaisance clandestine. Quand les gens ont le courage de plier et briser les règles, il se passe des choses extraordinaires, qui sont importantes dans le processus de valorisation d’un artiste. Mais ça ne veut pas dire que c’est la seule chose que tu devrais faire.
Je trouve ça fermé d’esprit de se dire : « Je ne vais faire que des choses illégales. J’aimerais peindre toute ma vie et en faire de l’argent, mais il n’y pas de street cred là-dedans, bro ! » C’est ridicule !
Donc je veux que les gens voient ce que je fais et y trouvent un facteur cool et novateur, mais je veux surtout que ça les pousse à essayer des choses dans leur propre vie. Les talents qu’il faut pour créer une œuvre d’art de rue qui a un impact, peuvent être utilisés pour démarrer sa marque de vêtements, ou travailler comme designer pour une compagnie ou une charité.
On a une image romantique de la personne qui travaille sur un chantier de construction toute sa vie en étant peintre amateur à temps perdu, c’est cute de l’extérieur. Mais la personne qui le vit préférerait probablement vivre de ses œuvres !
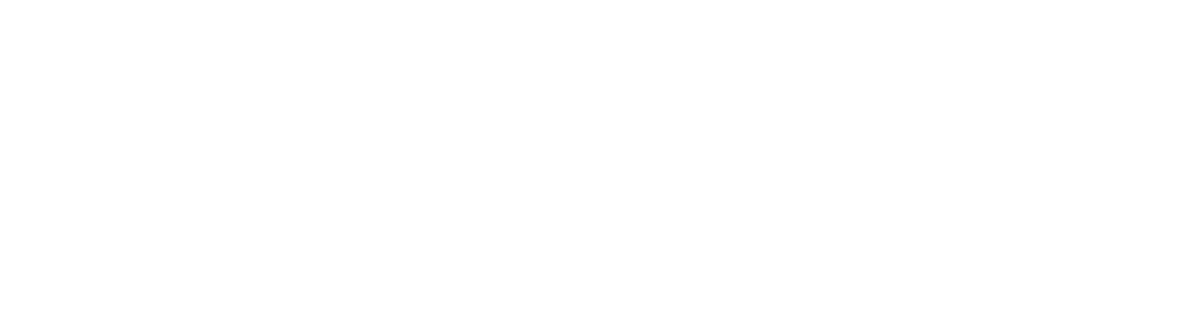
.jpg)
Identifiez-vous! (c’est gratuit)
Soyez le premier à commenter!